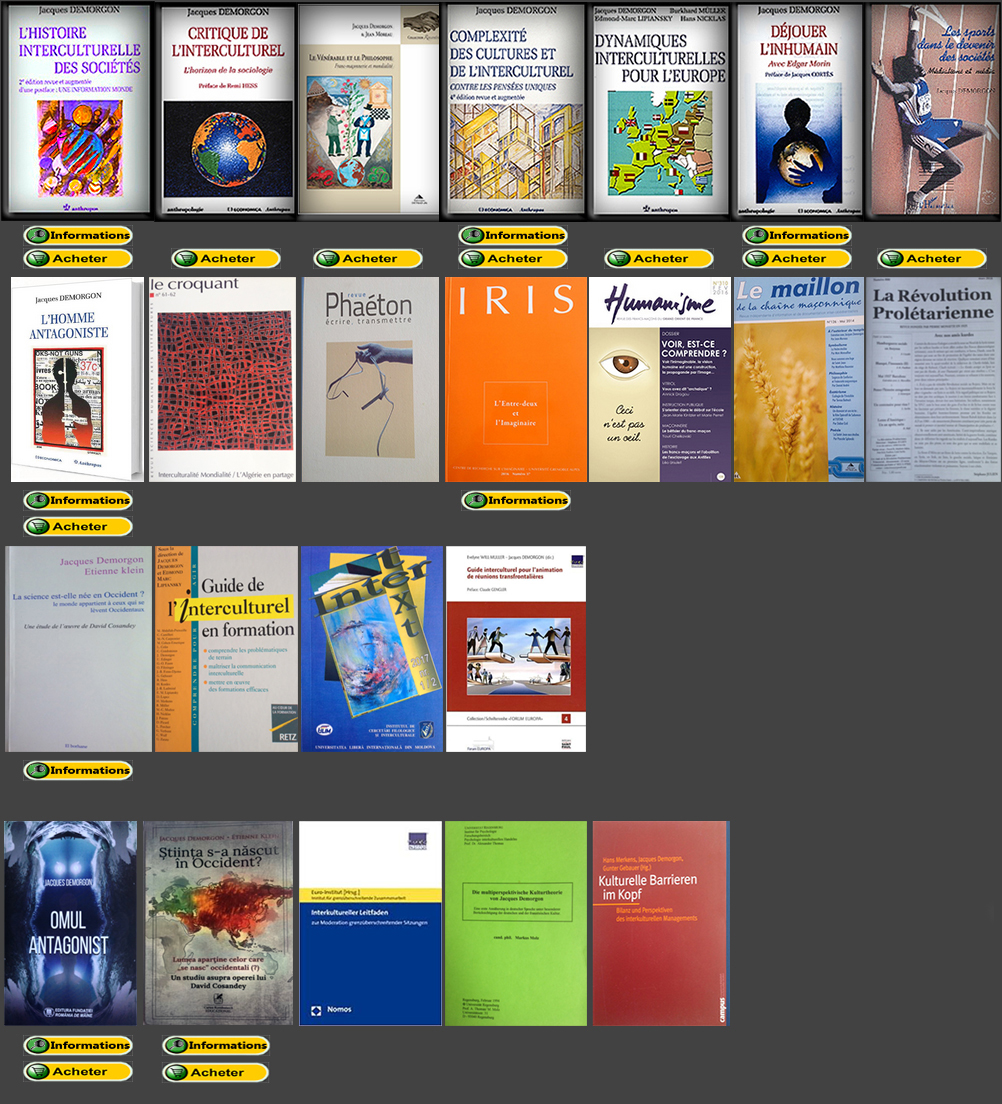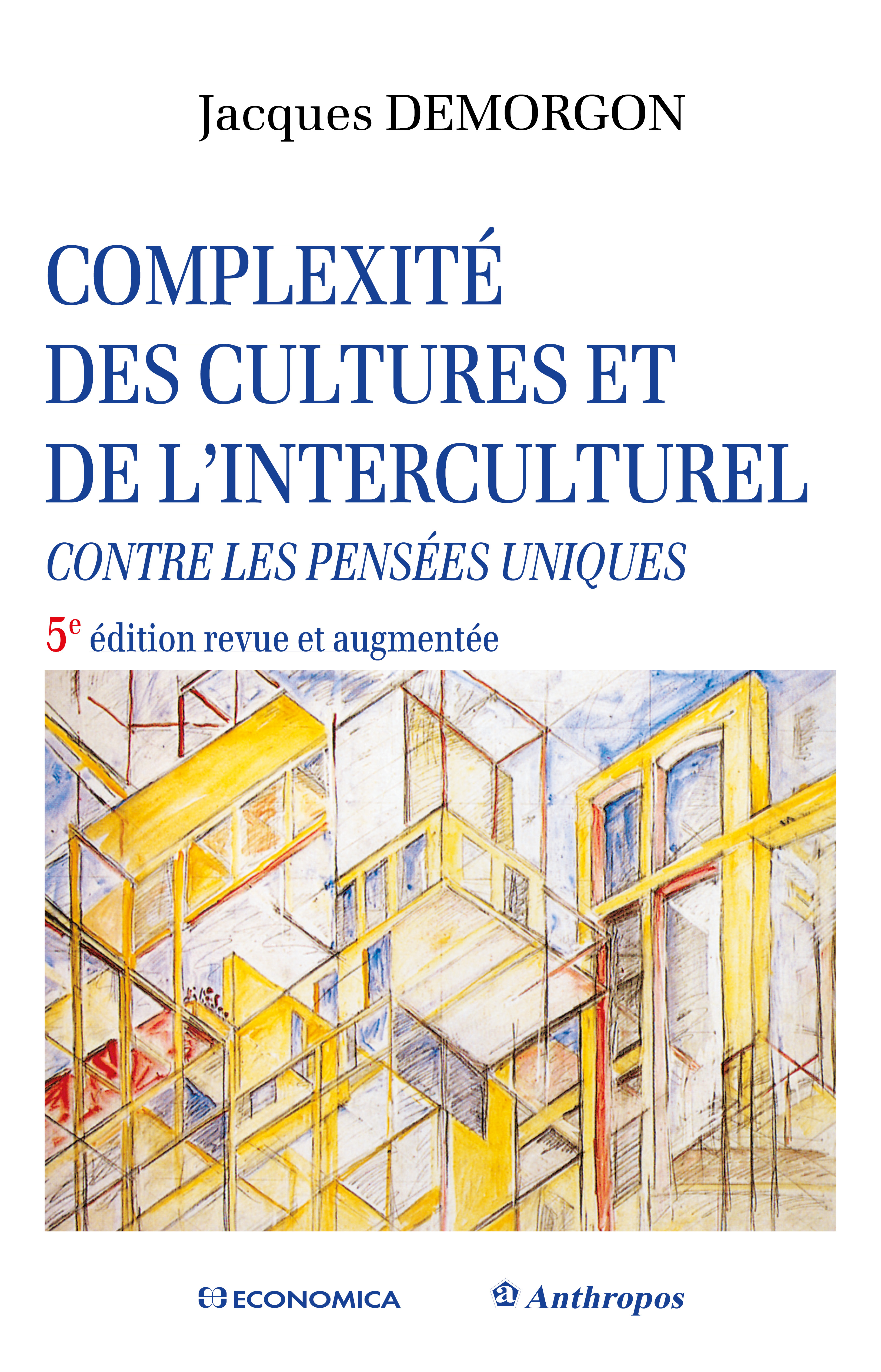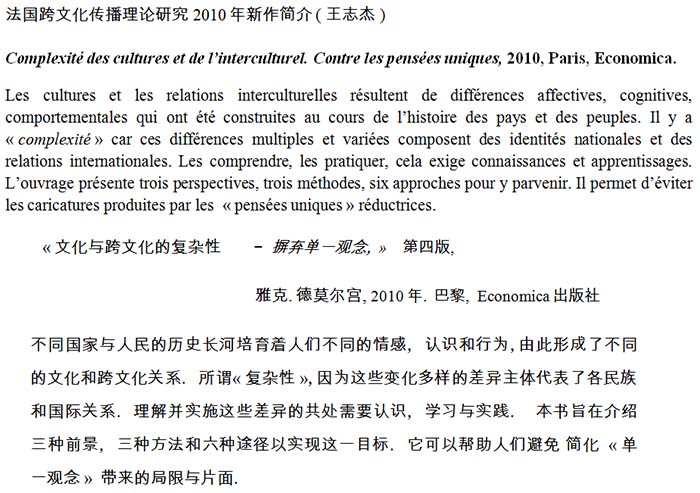|
|
Accédez directement à l’information qui vous intéresse en cliquant sur l’un ou l’autre des titres numérotés qui suivent :
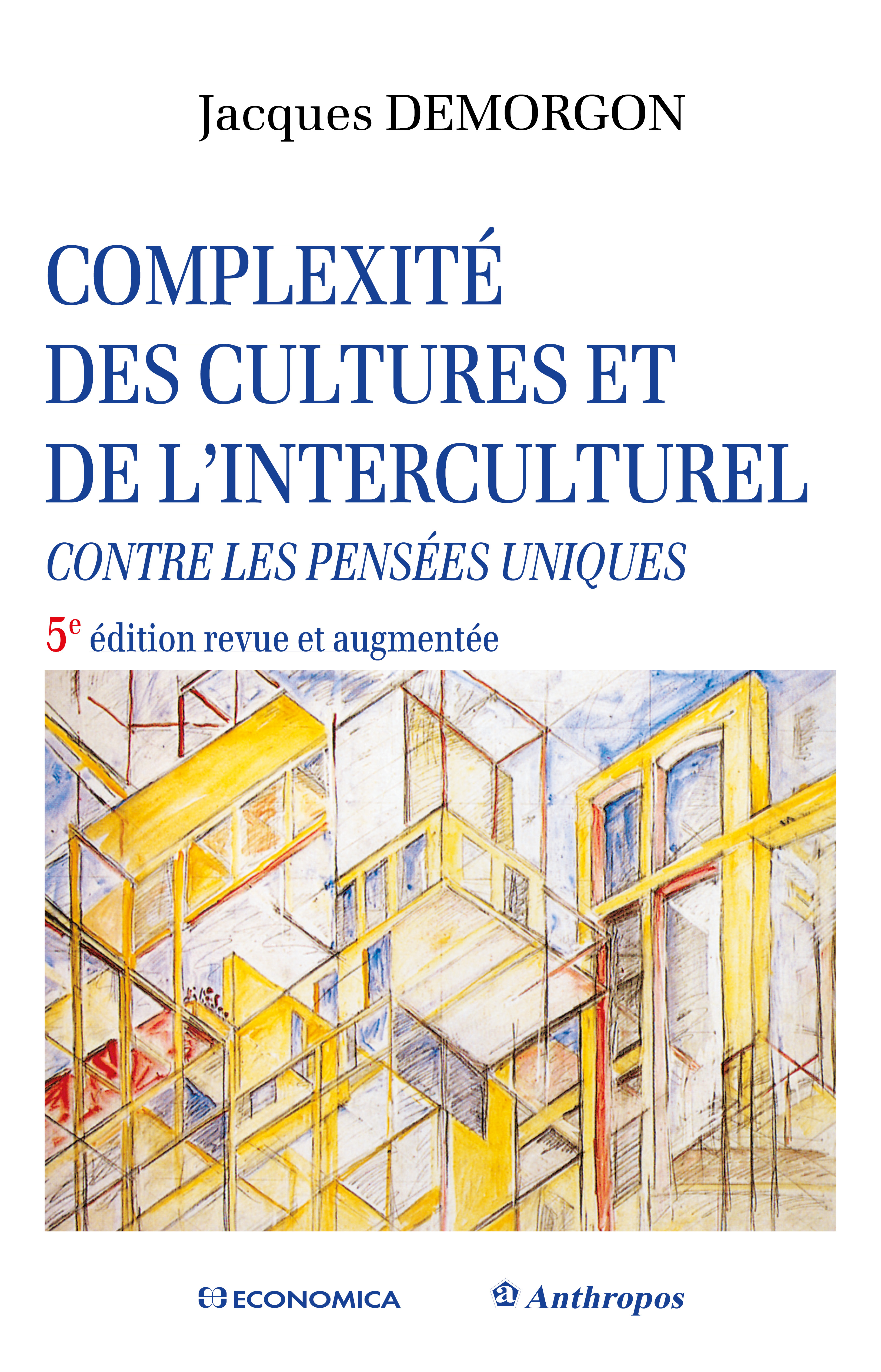

|
|
0. Histoire des cinq éditions du livre
0. Histoire des cinq éditions du livre
Complexité des cultures et de l’interculturel. Contre les pensées uniques en 5ème édition parution début septembre 2015.
La 5e édition - revue et augmentée - de Complexité des cultures et de l’interculturel. Contre les pensées uniques offre un Avant-Propos et un chapitre onze de quarante pages intitulé : Devenirs des cultures à l’échelle du monde, dont nous donnerons un extrait à la parution.
Brève histoire d’un livre manuel fondamental d’études rigoureuses et fécondes des cultures
C’est en 1996 que paraît, pour la première fois, Complexité des cultures et de l’interculturel, aux éditions Economica dans la collection dirigée par L. Colin et R. Hess et intitulée Exploration interculturelle et sciences sociales nommée ainsi à partir du précédent livre de Jacques Demorgon L’exploration interculturelle. Pour une pédagogie internationale, coédité, en 1989, en France par A Colin et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (Paris 13e) l’Ofaj et, en Allemagne, par Dfjw et Campus.
En 1996, Complexité des cultures est coédité, dans les deux pays : par Economica et l’OFAJ & par DFJW et Campus.
En 2000, la seconde édition est sous-titrée « Contre la pensée unique ». Elle est remaniée et complétée en ce qui concerne les cultures de l’Europe. Par contre, elle se libère des études sur les Etats-Unis et le Japon qui figuraient en 3e partie.
Ces études sont reprises, approfondies et développées dans un nouvel ouvrage intitulé L’interculturation du monde. Avec une couverture et des dessins de Michel Granger. Ouvrage, aujourd’hui épuisé, qui doit à l’avenir être de nouveau repris, complété et actualisé à la lumière des premières décennies du XXIe siècle.
Par ailleurs, dans la mesure où Complexité des cultures et de l’interculturel est un ouvrage de théories épistémologiques et méthodologiques, même si d’importants exemples concrets l’accompagnent, un autre ouvrage se devait de prendre en charge les questions plus historiques de genèses des cultures.
Dès 1998, les éditions Economica publient L’histoire interculturelle des sociétés. L’ouvrage est réédité en 2002 avec le sous-titre : Pour une information monde.
Complexité des cultures et de l’interculturel va connaitre une troisième édition - en 2004 - avec un nouveau sous-titre Contre les pensées uniques. L’ouvrage comporte trois nouveaux chapitres concernant trois perspectives différentes prises sur les cultures : en les particularisant, en les généralisant, en les singularisant.
En 2010, la quatrième édition comporte un premier chapitre Objets et méthodes, en partie nouveau qui ajoute aux deux méthodes classiques – comparative-descriptive et compréhensive-explicative – qui relève de la connaissance – une troisième méthode « dialogique-implicative » qui surmonte la trop continuelle coupure de la connaissance et de l’action. De nouvelles conclusions sont développées dans une perspective programmatique.
La 5e édition en 2015 reprend cette perspective programmatique et la développe autour d’un important chapitre supplémentaire : le chapitre XI intitulé « Devenirs des cultures à l’échelle du monde ». Cela résulte d’une profonde initiative de recherches prise par le penseur moldave Victor UNTILA. Il a fortement relié l’interculturel à 4 grands domaines : histoire, sémiologie, pragmatique, herméneutique. Jacques Demorgon s’y est volontiers associé à travers quatre études fondamentales publiées dans La Francopolyphonie, n° 7, 8, 9, 10, revue de l’ULIM, Chisinau, Moldavie. Voir sur la revue l’édito du 1er mars 2015 et les prochains éditos portant sur l’anglais avec les abstracts de ces articles.
Désormais, les éditions successives de Complexité des cultures et de l’interculturel se placent clairement dans la perspective de cette discipline ancienne mais profondément renouvelée (Gadamer, Ricoeur, Vattimo) que l’on peut nommer l’herméneutique historiale ensembliste antagoniste. D’où, ainsi, l’intérêt de cette nouvelle édition 2015 de Complexité des cultures et de l’interculturel. Contre les pensées uniques.
1./ J. Mardirossian, France-Arménie
1./ J. Mardirossian, France-Arménie
Une mine d’or à décrypter sur l’évolution des cultures. Nous savons ce qu’est la culture agricole, mais que couvre la culture de l’esprit. Comment prend-elle naissance et se développe-t-elle ? L’auteur nous livre un savoir ample d’une grande profondeur. Le texte croule sous la richesse conceptuelle qu’il n’est pas possible de tout décoder pour l’auteur, ne serrait-ce que par manque de place. « C’est une révolution mentale dans la pensée des cultures et de l’interculturel ». La culture des mœurs et la culture savante formant un tout se nourrissent mutuellement en se préservant et en se renouvelant via des stratégies spécifiques. La culture s’installe au cours d’une histoire globale, longue et commune. L’interculturel qui est une seconde nature de l’humanité, avec toute sa fécondité et sa violence engendre une évolution permanente. Pour l’auteur, la culture est « un fait social total » présent dans les grandes activités humaines : religion, politique, économie, information. Hier, la religion associée à la politique contrôlait l’économie et l’information, alors qu’aujourd’hui, c’est l’inverse. Au lieu d’associer ces quatre secteurs, on les a mis en compétition. En outre l’analyse historique définit quatre formes d’organisation correspondant à quatre périodes : tribale, royale, nationale et mondiale. Quant à l’interculturel sa matrice a trois foyers décisifs qui sont des « adaptations antagonistes » : « des actions en directions opposées ; des activités entre secteurs opposés ; des organisations entre formes sociétales opposées ». En fait ces antagonismes humains sont créateurs. Entre ouverture/fermeture, unité/diversité, stabilité/mobilité…, l’homme doit composer ses actions ; entre religion, politique, économie, information, l’homme doit composer ses activités ; entre tribal, royal, national et mondial, il doit organiser l’ensemble humain qu’il constitue. Dans la mondialisation devenons-nous multiculturels, transculturels ou interculturels ? Le multiculturalisme prime pour les cultures très différentes ; le transculturel apparaît lorsqu’il y a volonté d’unification de cultures différentes et l’interculturel intervient quand il y a possibilité de transmission entre multiculturalité et transculturalité, préconise Jacques Demorgon. « La triade des 3 conduit à rechercher la meilleure adaptation. » Il est important de recourir à la logique des antagonistes ; pour l’opposition ouverture/fermeture, par exemple : grâce à la fermeture, un être s’abrité, se préserve et se reconstitue et grâce à l’ouverture, il s’exerce, s’éprouve, se renouvelle. Ce n’est pas l’équilibre qui est recherché, mais l’optimisation en fonction des circonstances, du degré d’opposition…. Les antagonismes entre en convergence, divergence ou complémentarité. « Cette logique est une vraie révolution dans la pratique de l’interculturel » même si « les antagonismes peuvent mener à des conflits et à la destruction ». L’auteur reprend la théorie d’E. Todd qui a un grand intérêt pour les cultures nationales ; les oppositions « autorité, liberté », et « égalité/inégalité » permettent de définir l’approche de huit types familiaux qui se transmettent dans le temps avec des incidences sur les orientations politiques. Avec ces outils d’analyse, cette révolution de l’interculturel antagoniste pourrait rendre l’histoire plus créatrice, moins destructrice. Une mine d’or qu’il faut parfois décrypter, pour l’évolution des cultures.
2./ Anonyme, Bulletin Critique du Livre en Français (BCLF)
2./ Anonyme, Bulletin Critique du Livre en Français (BCLF)
Dans les milieux universitaires de l’interculturel, Jacques Demorgon est un auteur parfaitement connu. Ses cours ont fait les belles heures de quelques années d’enseignement ainsi que celles du serveur audio de l’université de Nanterre. C’est dire si, dans ce cas, la publication de ses cours est importante, dans la mesure où elle permet, plus que la version orale, la réflexion, l’étude rigoureuse et l’imprégnation lente. Dans d’autres milieux, l’auteur est probablement peu connu, mais il faut alors signaler Complexité des cultures et de l’interculturel à toutes les personnes qui travaillent dans un cadre interculturel, qu’il s’agisse de milieux professionnels ou de milieux éducatifs. Car les démarches rassemblées ici, les indications suggérées, les propositions de réflexion faites aux uns et aux autres, favorisent la compréhension des dynamiques multiculturelles dont on sait qu’elles ne peuvent plus, depuis longtemps déjà, être regardées de loin ou avec mépris. Qu’en est-il donc du contenu de l’ouvrage ? Tout en précisant que l’auteur est parfaitement lisible par tous ceux qui s’intéressent à ces problèmes, on peut préciser d’abord qu’il est question de donner les moyens les moyens à chacun de cerner la notion de culture, puis ceux d’approcher les différentes cultures ainsi que les cultures dans leurs différences. Enfin, l’auteur complète cette perspective en proposant une piste de réflexion portant sur la genèse des cultures, ici pensée au travers de la genèse des cultures européennes et des antagonismes explicites entre les cultures allemande et française. Évidemment, pour rendre son ouvrage explicite et exploitable dans les situations concrètes de l’existence, l’auteur prend la peine de spécifier le vocabulaire dont peut avoir besoin tout animateur culturel, tout chercheur de terrain culturel, tout chercheur de terrain et tout étudiant dans le domaine interculturel. Parmi les concepts centraux, ceux de « tout » et de « partie », ceux de « particularité », de « totalité », de « généralité », de « totalité », de « généralité » et « singularité ». Avec la même précision, l’auteur distingue, clairement et de manière utilisable, les perspectives synchronique et diachronique en matière d’approche des cultures. Illustré par de nombreux exemples, pourtant parfois un peu rapidement exposés, le texte donne au lecteur le désir de se lancer dans des analyses plus personnelles. C’est dire alors si une bonne partie de l’ouvrage peut sembler asse proche d’un manuel d’analyse et de recherche destiné au chercheur de terrain. Du moins procède-t-il parfois à des indications, qui au lieu de paraître superficielles, comme on pourrait le croire au premier abord, doivent être traduites en suggestions (de lecture, d’enquêtes, de fouilles) de travail futur.
3./ L. Colin, R. Hess. Préf. 4e éd. Une révolution mentale dans la pensée des cultures et de l’interculturel…
3./ L. Colin, R. Hess. Préf. 4e éd. Une révolution mentale dans la pensée des cultures et de l’interculturel…
Nous sommes heureux de présenter la 4e édition de Complexité des cultures et de l’interculturel. Contre les pensées uniques. Le livre est apprécié : « contribution majeure », « méthode exigeante », « savoir profond », « précieuse synthèse ». Jacques Nimier le qualifie de « véritable manuel, indispensable à tous ceux qui se préoccupent des cultures ». L’ouvrage s’accroît et se perfectionne mais ne se périme pas. Pour nous, qui avons découvert et préfacé les versions successives de l’ouvrage, la conclusion de cette 4e édition : « L’homme et ses cultures » nous a encore surpris et instruits. Offrons aux futurs lecteurs un aperçu de ses riches contenus méthodologiques, pragmatiques et théoriques.
Une révolution mentale dans la pensée des cultures et de l’interculturel. Pour Jacques Demorgon, la culture est un « fait social total », comme fruit des adaptations de l’acteur humain en tout domaine. Ludique, esthétique, technique, scientifique, médiatique, la culture est aussi religieuse, politique, économique. La culture humaine n’est pas séparable : culture anthropologique et culture cultivée s’entretiennent comme elles le font avec les cultures singulières des personnes, groupes ou pays. Il n’y a pas non plus de cultures sans stratégies qui les maintiennent ou les renouvellent. Dans ces conditions, l’interculturel est plus qu’une nécessité d’aujourd’hui, c’est une constante du devenir humain. Il doit être notre référence à condition de ne pas l’idéaliser mais de chercher à le comprendre dans son intégralité avec ses dimensions de violence. Accomplir cette révolution mentale est un préalable pour tout futur citoyen mondial. Elle dépend de conditions très exigeantes : trois perspectives, trois méthodes, six approches des cultures et de l’interculturel. L’auteur met en évidence leur longue élaboration au cours de l’histoire humaine et de son analyse par des chercheurs de toute discipline. C’est la raison de leur étonnante fécondité dès que les chercheurs ont la capacité de les conjuguer. Prenons d’abord, en exemple, l’approche sectorielle.
Comment les humains gâchent religion, politique, économie et information ! L’approche intersectorielle traite des grandes activités humaines : religion, politique, économie, information. Comment aurait-elle pu exister sans la reconnaissance préalable de l’existence des secteurs ? Certes, la religion est reconnue de longue date. Aristote a clairement qualifié l’homme d’animal politique. L’information a d’abord été présente dans les autres secteurs comme en témoigne la notion de vérité révélée détenue par les acteurs du secteur religieux. L’économie a mis plus longtemps à convaincre de son importance. On sait le rôle qu’a joué Marx. Quant à penser « grands secteurs », et « sous-secteurs », dans leurs agencements et leurs conflits, c’était encore plus difficile. Au plan événementiel, l’invention de la laïcité comme pouvoir du politique de pacifier le religieux est récente (loi de 1905, en France). On n’a pas assez remarqué une étonnante coïncidence. C’est en 1905 que paraît L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, ouvrage magistral dans lequel Max Weber démontre la profonde reliance du religieux, du politique et de l’économique. Peu après, les travaux de Georges Dumézil sur les panthéons et les épopées des sociétés indoeuropéennes caractérisent leur imaginaire par une tripartition hiérarchique descendante des valeurs religieuses, politiques, économiques. De Marx à Weber et Dumézil, l’approche interculturelle des secteurs d’activités est née mais elle n’est toujours pas comprise comme approche décisive des cultures et de l’interculturel. On ne sait pas voir le piège renouvelé que représente la domination de tel secteur sur les autres. Les acteurs humains ne comprennent toujours pas la nécessité absolue d’associer religion, politique, économie et information. En se centrant sur seulement tel secteur au détriment des autres, ils continuent à cumuler les monstruosités. Hier, elles ont été religieuses et politiques ; aujourd’hui elles sont économiques et informationnelles. Les approches proposées par Jacques Demorgon sont précieuses pour la compréhension de l’histoire humaine mais tout autant pour s’impliquer mieux dans son devenir. Dans cet esprit, au delà des classiques méthodes comparative et explicative, une troisième méthode, implicative, est nécessaire. René Lourau s’y était engagé dans Implication, Transduction, livre que Jacques Demorgon commente dès L’histoire interculturelle des sociétés.
Comment les humains appauvrissent leur histoire ! L’approche diachronique ou historique est fondée, elle aussi, sur un vaste ensemble de travaux. Jacques Demorgon présente et analyse une quinzaine de grandes périodisations historiques : de Comte et Spencer à Girard, Deleuze, Debray, Mac Luhan, Gaudin, Harris, Baechler et Lévy. L’analyse de ces grandes synthèses fait apparaître, le plus souvent, quatre périodes ayant chacune sa forme organisationnelle dominante. En simplifiant, disons : tribale, royale, nationale et mondiale. Mais on est loin d’un évolutionnisme linéaire et réducteur, chaque forme éliminant la précédente. Tout change mais se mêle. Rien n’est définitivement fixé. Les tribus sont entre les communautés et les chefferies étudiées par Pierre Clastres. Les royaumes deviennent des empires. Les nations ne sont plus impériales en elles-mêmes mais se constituent des empires coloniaux. Aujourd’hui, qu’en est-il de notre forme dominante de société qui confronte toutes les formes antérieures aux dimensions continentales et même planétaires ? L’approche diachronique ou historique est, elle-même, toujours en invention. Non seulement l’histoire n’est pas finie mais elle se complexifie associant nouvelles menaces et nouvelles ressources. Les approches étendent et approfondissent ensemble leurs capacités d’analyse et de synthèse. Ainsi l’approche sectorielle, associée à l’approche historique, définit la genèse des formes d’organisation successives des ensembles humains. A la suite de Dumézil, on comprend que ce qui fonde un royaume ou un empire c’est la capacité des acteurs du religieux et du politique à s’unir, plus ou moins, pour contrôler les acteurs de l’économie et de l’information. A la suite de Polanyi, de comprendre que la modernité résulte d’un renversement : les acteurs de l’économie et ceux de l’information, associés, contrôlent désormais les acteurs religieux et politiques. La suite est à venir.
Des antagonismes humains créateurs. L’aventure humaine est loin d’être terminée. Au-delà d’un Fukuyama croyant que l’histoire était finie ; au-delà d’un Huntington prédisant le clash des civilisations, Jacques Demorgon montre l’acteur humain aux prises avec la complexité de grandes adaptations antagonistes. Entre ouverture et fermeture, stabilité et mobilité, centre et périphérie, l’homme doit composer ces actions. Entre religion, politique, économie, information, il doit composer ses activités. Entre tribal, royal, national et mondial, il doit organiser l’ensemble humain qu’il constitue. Il fait tout cela dans une multiplicité de stratégies séparées, contradictoires et conflictuelles. Les sociétés, leurs groupes et leurs membres, s’engendrent avec leurs cultures. Souvent, sans comprendre les résultats obtenus. D’où les approches, stratégique, et (auto) organisationnelle, à conjoindre, car si une nouvelle grande forme sociétale s’affaiblit et si une autre prend l’avantage, ce n’est pas le produit de pures volontés humaines formulées d’avance. Toutes ces approches des cultures et de l’interculturel ont valeur de garde fou pour l’apprenti sorcier qui sommeille toujours en l’homme. Ces puissants outils d’analyse pour la connaissance et de synthèse pour l’action sont, aujourd’hui encore, absents de notre culture actuelle. Ils sont ici présents dans cet ouvrage. Jacques Demorgon, dans une troisième partie, nous les montre à l’œuvre dans la recherche des sources familiales, politiques, religieuses, économiques des cultures européennes. Il montre ensuite comment, par exemple, deux ensembles, pourtant voisins, comme la France et les pays germaniques se sont engendrés de façon fort contrastée. Jacques Demorgon a, aujourd’hui, poursuivi ce genre d’études pour nombre d’autres pays, singulièrement pour les Etats-Unis, le Japon et la Chine. Tout son travail montre cependant que les grandes difficultés persisteront si nous les posons seulement en termes de personnes, de groupes et de pays. Sous ces grandes singularités qui nous fascinent se tient la matrice du devenir interculturel humain. Ses trois foyers décisifs sont les adaptations antagonistes des actions entre directions opposées - des activités entre secteurs opposés - des organisations entre formes sociétales opposées. Sur la base de cette révolution cognitive, éthique et pragmatique de l’interculturel antagoniste, l’histoire pourrait être demain moins destructrice et plus créatrice. Bien loin des illusions des philosophies de l’histoire, Jacques Demorgon nous invite au cœur de l’histoire en train de se faire avec ses sociétés, ses groupes, ses acteurs et leurs cultures.
4./ Table des matières.
4./ Table des matières.
L’homme au risque de la culture infinie
Première Partie
TROIS PERSPECTIVES SUR LES CULTURES
Chapitre I : Objets et méthodes
Chapitre II : Particulariser
Chapitre III : Généraliser
Chapitre IV : Singulariser
Deuxième Partie
SIX APPROCHES DES CULTURES
Chapitre V : Approche synchronique et logique des anta gonismes
Chapitre VI : Approche historique ou diachronique
Chapitre VII : Approches stratégique et auto-organi sationnelle
Chapitre VIII : Approches dimensionnelle et sectorielle
Troisième Partie
DES SOCIETES, DES CIVILISATIONS ET DES HOMMES
Chapitre IX : Genèse des cultures européennes : compo santes familiales, politiques, religieuses, économiques
Chapitre X : Genèses antagonistes des cultures alle mande et française
Chapitre XI : Devenirs des cultures à l’échelle du monde
Bibliographie
5./ Cl. Barthélémy, Centre Lebret-Irfed. Développement et Civilisations. Fiche 17.
5./ Cl. Barthélémy, Centre Lebret-Irfed. Développement et Civilisations. Fiche 17.
Une lecture du livre de Jacques Demorgon. A partir de l’idée que la culture est présente dans tous les secteurs de l’activité humaine, Jacques Demorgon propose un travail de conceptualisation sur les cultures et l’interculturel. Son but est de permettre à une personne qui s’y intéresserait de comprendre comment les conduites habituelles des hommes peuvent être source de complémentarité ou de conflit. L’auteur prend bien la précaution de dire que les conduites culturelles sont probables, mais pas certaines, il parle d’effets « statistiques », une autre conduite que celle à laquelle on pourrait s’attendre étant toujours possible. C’est un point qui n’est qu’évoqué en introduction mais qui me semble important pour ce domaine dans son ensemble, et notamment pour ce que l’auteur appelle la génétique prospective des cultures : une personne ne va pas forcément agir comme cela a été observé dans sa culture, quelle qu’elle soit (nationale, religieuse, économique, sociale, etc.), elle garde toujours ce que l’auteur appelle une capacité d’adaptation et d’oscillation, mais aussi d’évolution. Jacques Demorgon revient sur ce point important quand il présente les genèses antagonistes des cultures allemande et française. Il explique que la catholicisation et la romanisation sont des éléments de différenciation importants mais qu’il n’y a pas d’ « influence magique qui fait perdurer un déterminisme devenu fatalisme » (p. 220). Ainsi, même si de nombreux éléments historiques peuvent expliquer des comportements actuels, l’histoire n’est pas un carcan culturel. Pourtant l’auteur s’interroge sur la raison pour laquelle l’être humain, possédant de telles capacités d’ouverture, adopte souvent des conduites restreintes, rigides. Ce livre est censé s’adresser à la réflexion et à l’action face à une situation interculturelle. Il est peut-être un peu compliqué pour être utilisé facilement comme support dans des situations données et mérite une lecture en profondeur. Jacques Demorgon propose différentes approches de la culture en se basant sur les recherches faites dans plusieurs disciplines, l’histoire, la sociologie, la biologie, la linguistique, etc. Il présente la complexité des situations culturelles au niveau des logiques qui les animent ou de l’histoire. Ses analyses permettent de comprendre certaines attitudes. Par exemple, face à une situation nouvelle, la réponse de la culture peut être soit un renforcement (qui peut passer pour de l’entêtement), soit un rééquilibrage (qui peut sembler contradictoire). En fait l’auteur soutient la création d’une nouvelle discipline : la génétique des cultures. L’expression est bien choisie car elle évoque à la fois les explications rationnelles, voire scientifiques, de certains éléments des cultures, mais aussi les infinies possibilités existantes, la complexité de la construction culturelle. Il propose une génétique rétrospective et une génétique prospective des cultures. La première se base sur l’histoire, et incite le lecteur à s’intéresser à tous les éléments de construction de l’identité européenne puis plus précisément allemande et française. L’histoire est en effet vraiment importante pour expliquer et comprendre beaucoup de situations actuelles. Elle offre le contexte des événements, des comportements. La génétique prospective des cultures cherche à prévoir, prévenir certaines situations sur la base de l’analyse des cultures et de l’interculturel. C’est une tendance de divers auteurs, qui n’est d’ailleurs pas absente de l’ouvrage de Samuel P. Huntington, Le choc des civilisations, et qui doit conduire à l’analyse, à partir du passé et du présent, des possibilités de l’avenir. Une démarche intéressante et utile, si l’on garde à l’esprit les capacités d’adaptation et d’évolution de l’homme et des cultures.
6./ L. Colin, R. Hess. Préf. 3e éd. Contre les pensées uniques
6./ L. Colin, R. Hess. Préf. 3e éd. Contre les pensées uniques
Au-delà de la joie toute naturelle qui accompagne chaque réussite éditoriale, il importe, du point de vue des directeurs d’une collection, d’être toujours plus clairs dans l’information concernant chaque livre. Complexité des cultures et de l’interculturel, sous-titré « Contre les pensées uniques» est un ouvrage qui a sa spécificité, son unicité. Ce qu’il apporte est aujourd’hui indispensable. De nombreux lecteurs le découvrent en le lisant. Bien d’autres en sont privés en raison de divers préjugés de notre culture ambiante. Premier préjugé : il n’y a de rigueur que dans l’effort mono-disciplinaire appliqué. Toute pensée interdisciplinaire n’est qu’une prétention illusoire. Second préjugé : ce que nous énonçons aujourd’hui sera bien vite périmé. Un ouvrage, qui date d’un ou deux ans, est déjà dépassé. Troisième préjugé : dans ces conditions, aucune pensée généralisante n’est aujourd’hui possible. Seules les vérités partielles, locales, momentanées, sont crédibles. La troisième édition de l’ouvrage comporte une toute nouvelle et importante première partie qui nous démontre les graves inconvénients qui résultent de ces trois préjugés et de quelques autres. Nous ne pouvons penser ni l’histoire, ni l’actualité, si nous opposons la particularisation, la généralisation et la singularisation. Chacune de ces trois perspectives est riche d’apports pour la compréhension des sociétés et des cultures. Jacques Demorgon consacre à chacune un chapitre pour nous montrer qu’elle est indispensable aux deux autres. C’est à travers les exigences supérieures de cette dynamique ternaire que notre pensée peut constituer la meilleure représentation de la réalité. Cette représentation doit pouvoir être plus ou moins maintenue, plus ou moins régulièrement améliorée dans la poursuite et l’échange élaboré des expériences. Sans cette dynamique ternaire, qui peut, seule, soutenir la qualité de la pensée, nous entrons dans la sophistique des pensées uniques. Celles-ci énoncent soit des particularités, soit des généralités, soit des singularités, sans entrer dans leur nécessaire dynamique contradictoire et associative. Au-delà de cet apport fondamental nouveau, cette troisième édition de Complexité des cultures et de l’interculturel, maintient, en seconde partie, l’exposé des six méthodes, rigoureuses et fécondes, d’approche des cultures. Nous les avions bien évoquées dans les préfaces aux précédentes éditions. Ce qu’il faut signaler, c’est que l’auteur ajoute d’importants annexes aux chapitres consacrés aux approches synchronique et diachronique. La méthode synchronique s’appuie sur la pensée antagoniste et complémentaire. Jacques Demorgon illustre les apports de cette pensée, à travers de multiples exemples d’antagonismes binaires, ternaires et quaternaires, tels qu’ils ont été élaborés depuis deux mille ans. Pour l’approche diachronique, ou historique, il présente une vingtaine d’auteurs qui, chacun de son point de vue, propose sa périodisation des grandes formes de société. Le rapprochement des différentes périodisations permet de comprendre les fondements et la validité de l’approche historique des sociétés et de leur culture. Les six méthodes d’approche des cultures sont ensuite associées et mises en œuvre pour fonder une analyse et une compréhension rétrospectives et prospectives des sociétés allemande et française et des conduites de leurs membres. Par contre, la partie qui, dans les précédentes éditions, portait sur le Japon et les États-Unis, n’a pas été reprise car Jacques Demorgon a développé l’étude de ces deux pays, avec celle de la genèse de la mondialisation, dans L’interculturation du monde. Avec ces diverses modifications, cette troisième édition de Complexité des cultures et de l’interculturel accentue son rôle de manuel de référence méthodologique et théorique dans les études des sociétés et de leur culture. Méthodologie et théorisations proposées permettent de fonder des études étendues mais aussi structurées et approfondies, constituant le meilleur antidote aux multiples pensées uniques.
7. N. Carpentier. Contre la pensée unique. Une vraie démocratie !
7. N. Carpentier. Contre la pensée unique. Une vraie démocratie !
« Nous avons aujourd'hui besoin de travaux fondamentaux comme ceux de Jacques Demorgon... L'auteur nous fait découvrir l'adaptation antagoniste comme antidote fondamental de toute pensée unique. Il nous présente aussi une vue géohistorique extrêmement claire et profonde... Au total, un savoir indispensable pour une vraie démocratie ! »
8./ N. Gervais. France-Antilles. Penser l’hier et l’aujourd’hui des cultures.
8./ N. Gervais. France-Antilles. Penser l’hier et l’aujourd’hui des cultures.
Un savoir multidisciplinaire : « A travers un vaste courant d'analyses multidisciplinaires qui va des universités aux médias, l'auteur nous donne des informations multiples et diverses pour penser plus profondément les réalités d'hier et d'aujourd'hui. »
9./ Bul. Adri. Un manuel de méthodes et de théories sur les sociétés et les cultures.
9./ Bul. Adri. Un manuel de méthodes et de théories sur les sociétés et les cultures.
L’auteur, philosophe et sociologue, chercheur auprès de l’Ofaj (Office franco-allemand pour la jeunesse), livre la mise à jour de ce manuel de référence méthodologique et théorique pour les études des sociétés et de leur culture. Il propose l’emploi conjugué de six approches (synchronique, diachronique ou historique, stratégique et autoorganisationnelle, dimensionnelle et sectorielles) pour aborder les cultures. Ces six méthodes sont associées ensuite pour une analyse rétrospective et prospective des sociétés allemande et française. L’auteur s’intéresse à la genèse des cultures européennes et plus particulièrement aux genèses antagonistes des cultures française et allemande.
10./ L. Colin, R. Hess. Préf. 2e éd : L’analyse des cultures
10./ L. Colin, R. Hess. Préf. 2e éd : L’analyse des cultures
Voici la 2ème édition de Complexité des cultures et de l’interculturel. Précisons pour le nouveau lecteur qu’il dispose avec cet ouvrage d’un véritable manuel de l’analyse des cultures. Au cours des échanges ou des coopérations professionnelles, les différences culturelles nationales ou autres apparaissent à travers difficultés de communication, chocs affectifs, incompréhensions éprouvées par les personnes. Mais on se retrouve dans l’incapacité de savoir ce qui est préjugé, stéréotype ou vérité concernant les caractéristiques culturelles. On recourt à l’enquête empirique à travers questionnaires et entretiens pour établir le constat des conduites actuelles. En fait, six approches représentent les exigences minimales pour que notre connaissance évite d’être partielle, partiale, caricaturale. Pour comprendre une culture, il faut analyser comment des acteurs humains l’ont produite et la mettent en œuvre. Cela peut comporter tout un ensemble de recherches se référant : a/aux problématiques humaines générales ; b/aux formes de sociétés ; c/à la manière dont s’y trouvent, diversement associés ou dissociés, le religieux, le politique, l’économique et l’informationnel ; d/Il faut en même temps se référer aux volontés singulières des acteurs ; e/au type de lien social qu’ils sont capables de construire entre eux ; f/à l’ensemble en autoorganisation de toutes les données humaines ou non, dans lesquelles cette culture s’engendre. L’exposé des fondements de ces six approches occupe la moitié de l’ouvrage. Il est fait à partir d’un ensemble très dynamique de références à de multiples travaux interdisciplinaires et internationaux. Une fois la méthode ainsi présentée, de façon riche et rigoureuse, l’auteur aurait pu s’arrêter. Mais, à côté de la méthode elle-même, il a voulu, dans la suite de l’ouvrage, partager avec le lecteur les données qui ont conduit à l’inventer, les premiers résultats qu’elle a engendrés. Cette méthode n’est pas sortie toute armée de son cerveau. C’est vingt-cinq années de travail collectif sur le terrain des formations-recherches franco-allemandes par la suite associées à la pratique de l’interculturel évolutif des entreprises, qui ont conduit à cette élaboration. L’un des points les plus novateurs de la méthode concerne l’enquête historique. C’est elle seule qui peut nous donner une compréhension en profondeur en permettant de suivre, parfois au long des siècles, la genèse des caractéristiques culturelles. Cette perspective est mise en évidence dans la deuxième partie de l’ouvrage à travers la présentation des genèses historiques des cultures allemande et française. L’auteur, dans une troisième partie, a voulu s’avancer avec ses lecteurs sur le chemin de l’analyse des cultures dans leur actualité même. Cela nous permet de constater avec lui qu’à l’interculturel des relations entre personnes et groupes de cultures différentes acquises, nous devons ajouter l’interculturel qui résulte des actions de toutes sortes que les hommes mettent en œuvre sur les choses et entre eux. L’interculturel est ainsi ce qui engendre les cultures. Dès lors, les cultures sont à relier aux stratégies. Elles sont produites par les stratégies mais elles les produisent aussi. De même, les cultures ne doivent pas être considérées comme passées. Elles sont toujours aussi en genèse. Sur ces bases, l’auteur indique clairement qu’il n’y a pas une mondialisation comprise comme une force homogénéisante des cultures mais des mondialisations qu’il convient de référer aux grandes régions du monde comme aux secteurs d’activités. Il y a ainsi des mondialisations déjà diversifiées selon qu’elles sont informationnelles, médiatiques, économiques et même aujourd’hui particulièrement financières ou selon qu’elles sont politiques, religieuses ou encore écologiques. En étudiant les évolutions récentes, en particulier celles du Japon et des Etats-Unis, l’auteur montre que les cultures singulières des pays jouent un grand rôle dans les mondialisations. Elles continueront à le jouer. Dans ce contexte, l’Europe devrait être en mesure de contribuer à l’invention d’une interculturalité nouvelle. Les sociétés et les cultures vont poursuivre leurs interactions et ce sera plutôt en direction d’une régionalisation du monde à laquelle ce livre est aujourd’hui à coup sûr une des meilleures introductions.
12./ E.M. Lipiansky, Communications & Langages. Une contribution majeure !
12./ E.M. Lipiansky, Communications & Langages. Une contribution majeure !
L’interculturel est un phénomène profond du monde d’aujourd’hui. Or nous manquons d’outils pour l’aborder car la plupart des notions qu’utilisent les sciences humaines se sont forgées dans le cadre de telle ou telle culture nationale. Pourtant, face au défi de la mondialisation, la réflexion interculturelle prospective prend une importance fondamentale à laquelle le livre ambitieux de Jacques Demorgon apporte une contribution majeure.
13./ J. Pateau. Cirac. Un savoir profond sur les sociétés et les cultures !
13./ J. Pateau. Cirac. Un savoir profond sur les sociétés et les cultures !
Jacques Demorgon pense nécessaire la constitution d’un savoir profond sur les sociétés et les cultures, tâche aujourd’hui plus aisée en raison des profonds renouvellements accumulés en un demi-siècle dans la logique, la science, l’histoire, la pensée stratégique, la philosophie éthique. Nous ne pouvons que conseiller au lecteur cet ouvrage. Il sera certain d’avoir entre les mains un outil pour entreprendre un voyage réflexif étendu et profond et mieux comprendre la complexité du devenir humain en cette aube du troisième millénaire.
14./ R. Hess. Préf. 1ère éd. L’Ofaj, un terrain des rencontres internationales. L’interculturel pratique et théorique.
14./ R. Hess. Préf. 1ère éd. L’Ofaj, un terrain des rencontres internationales. L’interculturel pratique et théorique.
Sous ce titre « Complexité des cultures et de l’interculturel », Jacques Demorgon étudie diverses situations interculturelles quotidiennes des personnes et des institutions. Ces situations constituent bien pour lui la base fondamentale comme en témoigne, particulièrement, sa présence régulière sur le terrain des rencontres internationales. Nous avons fait, dans ce contexte, sa connaissance à Diessen, en Bavière, voilà quinze ans. On connaît encore trop peu l’existence de ce terrain de recherches oririginal sur lequel nombre de chercheurs allemands ou français se sont mis à l’école et à l’épreuve. C’est un terrain composé par les rencontres instituées dans le cadre de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et de son service de recherches. C’est un terrain d’expériences triplement diversifiées. 1/Le chercheur peut entrer par les observations-participantes dans les rencontres de base : scolaires, professionnelles, artistiques, sportives ou syndicales. 2/Les sessions d’exploration et d’expérimentation offrent un temps plus ouvert aux échanges spontanés autour de thèmes développés en fonction des appartenances et références nationales et culturelles. 3/Les cycles de formation-recherche de longue durée, représentent, pour les chercheurs et les participants une situation exceptionnelle. Un noyau de participants de diverses nationales et cultures se retrouve à plusieurs reprises au long de trois années avec une équipe, elle-même internationale et interdisciplinaire, de chercheurs. Cette régularité, cette constance dans l’échange, constitue un tremplin pour des recherches poursuivies et approfondies… Quel a bien pu être le chemin suivi par l’auteur, depuis ce terrain des rencontres jusqu’à la conceptualisation de la réflexion, de la recherche et de la compréhension interculturelles ?... Les participants s’opposaient beaucoup sur les rôles de l’interculturel dans l’évolution actuelle des sociétés. Pour les uns, c’était un leurre qui cachait la mise en place d’une culture de plus en plus homogène… Pour d’autres, c’était la seule voie vraiment éthique qui nous restait… Les cultures étaient souvent vues par les uns comme des survivances du passé qui devaient finalement disparaître. Pour certains au contraire, il y avait des perspectives culturelles fondamentales qui pouvaient se maintenir à travers les siècles… Quand, dans les rencontres, on parvenait à maintenir ensemble ces aspects opposés, les débats étaient plus profonds et plus étendus… Pourquoi ne pas interroger l’histoire des pays pour découvrir comment ces caractéristiques se sont engendrées, depuis quand, et comment elles se sont maintenues ou ont déjà disparu ? C’est ce que Jacques Demorgon a entrepris, installant ainsi dans la recherche interculturelle un projet nouveau. Référer les conduites culturelles actuelles aux stratégies d’hier qui les ont engendrées comme aux stratégies d’aujourd’hui qui les maintiennent, les modifient ou les abandonnent. La culture sort du ghetto du passé ou on la renvoyait sans cesse. Elle n’est qu’au présent même si elle était déjà là, hier… Jacques Demorgon aborde la mondialisation par un pluriel : les mondialisations. Pourquoi ? L’interculturel est le fruit d’une interaction entre tous les secteurs d’activité humaine : du religieux au politique et à l’économique ; du technique au scientifique et à l’esthétique. Mais tel secteur peut être davantage celui qui, à un moment donné, met de nouveau « en travail » tous les autres. Hier, l’économique. Aujourd’hui, l’informationnel. Comprendre les situations et les relations interculturelles actuelles peut renvoyer à l’histoire comme créatrice de cultures mais aussi aux stratégies d’aujourd’hui composant déjà en partie la culture de demain. Il s’agit alors d’une génétique prospective des cultures et de l’interculturel. Jacques Demorgon situe ainsi l’interculturel au cœur de la naissance d’un nouveau courant culturel historique qu’il nomme informationnel mondial… Le présent livre devrait y contribuer. Les résultats qu’il obtient n’étaient pas attendus si vite, leur besoin va sans doute maintenant se développer.
15./ L’homme multiple : la méthode comparative descriptive.
15./ L’homme multiple : la méthode comparative descriptive.
La méthode comparative descriptive est pluridisciplinaire. Elle se réfère à une pluralité de disciplines : biologie, psychologie, sociologie. Autant de cultures, de publics, de situations quotidiennes et professionnelles, autant de conduites et de significations différentes. D’un pays à l’autre, une couleur, une fleur, un animal, un geste, peuvent changer de sens. Il en va de même en ce qui concerne l’offre de cadeaux, le fait de servir des aliments ou des boissons à tel moment de la journée. Pareillement, pour ce qui est des modes vestimentaires selon les circonstances, et des façons d’inviter autrui ou de se rendre chez lui, etc. Ces particularités sont infinies. Bien souvent, elles relèvent de codes appris dans l’enfance ou plus tard. On donne ou non une poignée de mains. On remet ou non sa carte de visite. Il est impossible, pour un individu, même globe-trotter, polyglotte et mime, d’accueillir ces innombrables particularités culturelles. La méthode comparative descriptive n’est pas récusable mais elle est devant une tâche infinie. Toutefois, elle a, dès ses premiers emplois, un mérite : elle combat la naïveté d’une croyance selon laquelle les autres ne sont pas si différents de nous.
16./ L’homme géohistorique : la méthode compréhensive explicative.
16./ L’homme géohistorique : la méthode compréhensive explicative.
La méthode compréhensive explicative est requise dès que l’on veut, non plus s’informer seulement sur les ressemblances et les différences culturelles, mais comprendre comment elles ont pu s’inventer dans l’histoire humaine. Jusqu’ici, en effet, l’interculturel de genèse, factuel, inattendu, surprenant se déploie dans l’histoire et défie l’intelligence et l’action humaines. L’incertitude quant à l’avenir, bénéfique ou maléfique, continue de terroriser les humains, du moins quand ils y pensent. D’où des traditions de recours aux rites, aux divinations et prières plutôt qu’à la connaissance. Cette connaissance des genèses géohistoriques des sociétés, de leurs membres et de leurs cultures ne peut être entreprise qu’en évitant le fatalisme qui annihile les volontés humaines et les rationalisations précipitées avec leurs explications illusoires. La méthode compréhensive explicative doit recourir à la pensée dans sa totalité, se saisissant du réel, selon les trois perspectives de particularisation, de généralisation et de singularisation portant sur les sociétés, leurs membres et leurs cultures. Ces trois perspectives de la pensée ne doivent pas être utilisées séparément mais associées. Les chocs qui se produisent entre elles peuvent seuls conduire la méthode compréhensive explicative à triompher des particularités dispersées à l’infini, des singularités extrêmes conduisant aux incompréhensions et des généralités abusives ou simplement inappropriées. La méthode compréhensive explicative n’a cessé d’être à l’œuvre tout au long de l’histoire humaine. Elle s’est toutefois trop souvent précipitée sur des compréhensions anthropomorphiques et des explications idéologiques d’une généralité sommaire. Elle s’est alors exprimée dans un écart antagoniste entre, d’un côté, les philosophies de l’histoire qui prétendaient en découvrir le sens unique et, de l’autre côté, des méthodes scientifiques rigoureuses souvent en difficulté pour se raccorder entre elles et produire du sens. En difficulté, au cœur de ce grand écart, la méthode compréhensive explicative est finalement parvenue à se construire interdisciplinaire et même transdisciplinaire. Elle y est arrivée en sélectionnant une pluralité d’approches en fonction des problèmes que la réalité lui posait. Ainsi, comment comprendre que tantôt les Hommes se détruisent et tantôt construisent ensemble ? Comment peuvent-ils inventer ces grandes activités séparées : religion, politique, économie, information ? Quels rapports ces activités ont-elles avec les grandes mutations des sociétés : « formidable métamorphose » des tribus en empires, « grande transformation » des empires en nations marchandes ? Comment référer, de façon compréhensive, la singularité des religions et celle des sociétés ?
Ces approches sont exposées en détail dans la seconde partie de l’ouvrage. On leur a conservé ce nom pour les distinguer des méthodes et des disciplines plus formalisées. Leur fonction est précisément de tâtonner, en rassemblant, de plusieurs façons, les particularités, les généralités et les singularités, mais aussi les diverses disciplines. Soulignons à l’aide d’un exemple récent les résultats qu’obtient la méthode compréhensive explicative transdisciplinaire. Lors du déploiement indoeuropéen, des peuples et des langues ont disparu ; d’autres, peu nombreux, ont subsisté. Pour certains, ils le devaient à leur localisation géographique. Ils avaient réussi à constituer des isolats culturels en montagne. Ou alors, ils se trouvaient à la limite de l’expansion indoeuropéenne. Par contre, la question basque était plus complexe et résistait aux explications. Elle allait trouver sa compréhension quand, en plus d’associer les disciplines classiques – sciences préhistoriques, archéologie, géographie, démographie, linguistique – on allait pouvoir recourir aussi à la génétique des populations, discipline qui permet de s’y retrouver dans les évolutions des métissages entre les peuples. Tout cela est clairement posé dès le titre de l’ouvrage transdisciplinaire et interculturellement fondateur de Cavalli-Sforza (1996) : Gênes, peuples et langues. Si les Basques et leur langue n’ont pas disparu, c’est qu’ils étaient engagés dans un déploiement conquérant d’ouest en est, quand les indoeuropéens se déployaient d’est en ouest. Plus nombreux et plus forts, les Indoeuropéens pouvaient repousser les Basques. Ils le faisaient mais dans des circonstances diverses qui ne comportaient pas que des violences et pouvaient entraîner divers métissages, précisément mis en lumière par la génétique des populations. Cela entraina des conditions nouvelles dans lesquelles les Indo-Européens cessèrent d’imposer leur conquête, laissant aux Basques leur abri d’origine.
17./ L’homme en devenir : la méthode dialogique implicative.
17./ L’homme en devenir : la méthode dialogique implicative.
Les deux précédentes méthodes, si précieuses soient-elles, ont une limite. Elles se cantonnent à la connaissance. Or, l’existence humaine est davantage. Elle est en même temps et souvent d’abord action. Elle est devenir. Les deux précédentes méthodes sont tournées vers ce qui existe déjà et veulent nous aider à comprendre comment cela est advenu. Mais, les sociétés, leurs membres et leurs cultures vivent et se développent dans le présent et aussi dans l’imaginaire du futur. Comment ces situations pourraient-elles être délaissées d’un point de vue méthodologique ?
Si nous voulons prendre en compte l’existence humaine, comme dialogique partagée d’action et de connaissance, nous avons besoin d’une transdisciplinarité supérieure. Elle doit être à la fois épistémique, pragmatique, éthique. Bref, existentielle. Elle doit pouvoir tenir compte de l’aventure humaine dans ses multiples ensembles en devenir pour que les personnes, les groupes, les sociétés y inscrivent leur action, leur réflexion, leur destin. Il y faut une troisième méthode soucieuse de l’inséparabilité de la connaissance et de l’action, comme du présent, du passé et du futur. La connaissance se situe en tension entre un champ bénéficiant des arts, des techniques et des sciences et un autre qui relève des seules croyances. L’action se partage de même. L’acteur, réellement impliqué, est aux prises avec les incertitudes des devenirs. Il éprouve la nécessité d’associer la connaissance et son manque, avec l’action et son manque. La connaissance, en cours de constitution, et l’action, transformatrice, se développent ensemble. Grâce à la méthode dialogique implicative, l’acteur humain peut relier dialogique d’information et dialogique d’action sur les concurrences, les conflits, les complémentarités. La première dialogique ne cesse de construire la meilleure information possible. Mais la seconde dialogique, qui est d’implication, teste cette information dans le réel. En même temps, elle la renouvelle et la développe du fait de l’expérience en cours. L’acteur humain éprouve le réel en même temps qu’il s’éprouve lui-même. C’est pourquoi, immergé dans le cours contradictoire des évolutions, il continue à distinguer, mais il ne sépare pas les faits et les valeurs. Il les relie et les invente ensemble (Putman, 2004).
18./ « Religion-politique-économie-information » : l’homme laïque in statu nascendi.
18./ « Religion-politique-économie-information » : l’homme laïque in statu nascendi.
Les actions, premières et multiples, se sont progressivement différenciées et organisées. Aux époques communautaires et tribales, on est cueilleur, chasseur puis, à partir du néolithique, pasteur, agriculteur. Conjointement, des activités différentes, non économiques, se sont toujours manifestées. Religieuses et politiques, elles étaient indispensables à la cohérence et à la protection de la société humaine. Les activités humaines se sont ainsi différenciées et regroupées jusqu’à produire de véritables secteurs d’activités : religion, politique, économie, information. Ils se sont constitués en s’opposant et en s’arrangeant entre eux. Leur dynamique relationnelle conflictuelle est apparue en pleine lumière avec les études de Max Weber sur la relation du protestantisme au politique et à l’économique et, peu après, avec les études de Dumézil sur la hiérarchisation tripartite des représentations imaginaires du religieux, du politique, de l’économique dans les sociétés indoeuropéennes. Le quatrième secteur, celui de l’information, mêlé à chacun des trois autres, s’est ensuite constitué en prenant de plus en plus d’autonomie. Le temps historique – au cours duquel les quatre secteurs d’activités se sont constitués, maintenus, développés, modifiés – se chiffre en millénaires. Il y a donc une probabilité très faible que l’un d’entre eux puisse disparaître dans un délai limité. Certains paraissent le croire pour le religieux et le politique. L’importance des secteurs d’activités ne doit pas donner lieu à une caricature du réel. Ils sont pris dans une systémique générale entre indifférenciation et différenciation. Religion, politique, économie, information ne sont pas données une fois pour toutes, ce sont leurs acteurs qui les construisent et cette construction se poursuit au travers même de leurs oppositions. Chaque secteur d’activités s’affaiblit, se renforce, se différencie à travers cette concurrence avec les autres secteurs. L’évolution est hypercomplexe car chaque acteur intervient, de façon plus ou moins libre, dans tous les secteurs, même s’il ne s’y investit pas de la même façon. Compte tenu de la relative récence de leur émergence comme catégorie fondatrice de l’histoire humaine, les « secteurs d’activités » sont diversement dénommés : « systèmes » (de Parsons à Luhmann), « puissances » (Lefebvre) « appareils » ou « champs », « ordres d’activité » (Baechler), (Morin, Bourdieu). Ajoutons que chaque grand secteur, se diversifie aussi en sous-secteurs. Ainsi, l’information est technique, ludique, esthétique, scientifique, médiatique, éthique, juridique. Au cours de ces évolutions, secteurs et sous-secteurs, interférant entre eux, produisent des secteurs mixtes comme le social. À partir des contraintes économiques modernes, le social s’est progressivement constitué à la lisière de la concurrence entre le religieux (la charité) et le politique (la solidarité). Il nous faut interroger l’évolution de la dynamique, associative ou dissociative, des secteurs d’activités. Elle peut nous guider dans l’exploration de l’avenir. Les acteurs de l’économique ne sont pas hors histoire. La dominance de l’économique se poursuivra-t-elle ? Au risque d’accroître ses perversions comme hier le religieux et le politique avec les croisades, la purification ethnique, le colonialisme et l’esclavage. Dans un premier temps, l’appel au politique a permis une laïcisation du religieux. Mais cela n’a pas empêché les catastrophes produites par les politiques étatiques au vingtième siècle. Certains ont cru pouvoir poser l’économique comme assurant de lui-même une laïcisation du politique. Ce n’est pas si simple. Le politique s’est d’abord sacralisé à partir du religieux. Ensuite, à partir des deux, l’économique s’est aussi sacralisé. Jean-Claude Guillebaud (2006 : 253) le note : le discours célébrant le libéralisme économique « est bien plus religieux qu’il ne pense (…) l’idéologie économiste est plus proche de l’idolâtrie que de la connaissance scientifique ». Jean-Michel Besnier estime, lui aussi, qu’il reste toujours à « laïciser l’économique ». Enfin, Guillebaud n’écarte pas même l’information de ce processus. Nous devrions pouvoir « laïciser l’information à commencer par les technosciences et les médias ». On le voit, la laïcisation se constitue comme un idéal, puis comme une règle s’appliquant à tous les secteurs d’activités pour éviter qu’ils ne se cléricalisent et deviennent hégémoniques et réducteurs. La difficulté est grande, on le comprend, aucun secteur ne peut, à lui seul, prétendre fonder une laïcisation générale. Seuls les antagonismes entre les secteurs et leurs partisans peuvent conduire observateurs, analystes et décideurs à entreprendre fermement une laïcisation réciproque. On en est loin. Il faudra passer par une période de laïcisations diverses partielles.
19./ Le libre-échange mondial : idéal trompeur de l’économique dominant.
19./ Le libre-échange mondial : idéal trompeur de l’économique dominant.
La structuration d’un livre oblige à traiter de façon séparée ce qui, dans la réalité, ne l’est pas. Il en va d’ailleurs de même dans cette conclusion. Nous devrions bien voir que les trois adaptations antagonistes ne sont pas séparables dans les faits. La forme de société qu’est la nation marchande s’est accompagnée de la formulation d’un idéal démocratique. Or, celui-ci se définit au travers d’orientations d’actions opposées. Par exemple, la liberté s’oppose à l’autorité. Il va de soi que c’est une indication symbolique car comment un ensemble social pourrait-il exister s’il excluait totalement l’autorité ? Le régime républicain s’oppose à la royauté absolue, régime dans lequel l’autorité était excessive. En opposition, il valorise la liberté. La forme de la nation marchande est aussi en relation avec une nouvelle hiérarchie des secteurs d’activités. Toutefois son évolution est complexe et varie selon les pays. La France, pays catholique, a longtemps privilégié le politique par rapport à l’économique. La Grande-Bretagne, pays protestant, privilégie l’économique par rapport au politique. Avec la mondialisation, cette évolution s’est encore complexifiée. Un cas exemplaire est certainement celui du dogme actuel d’un libre-échange absolu et mondial. On y trouve des oppositions entre le politique et l’économique. De même, des oppositions entre protection et prise de risque. Plus profondément, on trouvera l’opposition entre la fermeture et l’ouverture, opposition présente dans tous les domaines. Aucune des deux orientations ne peut être éliminée. Faire du protectionnisme le « tout mal » et du libre-échange le « tout bien » est plus que suspect. Comment le libre-échange pourrait-il être à lui seul la panacée universelle, garantissant l’optimisation de l’économie mondiale ? A l’opposé, comment le protectionnisme pourrait-il être le bouc émissaire responsable de tous les malheurs du monde ? Le vrai problème de l’histoire humaine actuelle réside dans la mutation du national au mondial. Cette mutation, inévitablement diversifiée en fonction des évolutions singulières des multiples sociétés, requiert logiquement des ajustements spécifiques. Un libre-échange généralisé au plan mondial ne permet pas ces ajustements singuliers. Il entraîne les sociétés dans des rivalités extrêmes sans se soucier de toute la casse qui en résulte. Il est d’autant plus important de comprendre quel piège grossier constitue le libre-échange généralisé. D’abord, c’est le pays à l’économie la plus avancée – qui dispose d’une monnaie dont il use à son gré – qui prône ce libre-échange total. Ainsi, ce sont ses propres avantages compétitifs qu’il impose aux autres économies, souvent plus faibles, voire pas encore constituées. De plus, cela ne l’empêche pas de tricher en avantageant ses entreprises nationales par le biais de détaxations qui équivalent à des subventions déguisées. L’OMC a dû condamner les Etats-Unis pour manquement à leur propre dogme du « libre » échange absolu. Nombres d’économistes, y compris étatsuniens, ne reconnaissent pas ce dogme du libre échange généralisé. Paul R. Krugman (1996, 2009), prix Nobel d’économie, en 2008, d’orientation libérale, a lui-même toujours émis des réserves à ce sujet. Son livre, « Pop Internationalism », en français La mondialisation n’est pas coupable, était déjà clairement sous-titré « Vertus et limites du Libre-échange ». Le libre-échange, imposé à toute la planète, constitue même une trahison du libéralisme économique originel. Ainsi, Adam Smith ne croyait à la concurrence qu’à condition de contrôler « la taille du marché et les règles du Jeu ». Il ne proposait les bienfaits du libéralisme qu’entre « des pays dont les niveaux de vie ne variaient que du simple au double ». On le voit, les adaptations antagonistes – entre actions, entre secteurs d’activités, entre formes de sociétés – relèvent d’une interculturation permanente. Les oppositions « fermeture, ouverture », « précaution, prise de risque », « protection, libre-échange », constituent non des situations de choix et d’élimination mais des situations de régulation dont les acteurs humains doivent se saisir au mieux des difficultés qu’ils rencontrent. Nous devrions avoir désormais cette culture – ce livre veut y contribuer – selon laquelle aucun idéal n’est légitime dès qu’il mutile la complexité de la nature, de la vie, de l’humanité. Comment ne pas comprendre que si nous tournons le dos aux régulations subtiles que la nature et la vie ont mises en œuvre, nous entrainerons l’humanité à sa perte et la vie elle-même sur la planète. Certes, les rapports de force jouent pleinement mais il y a bien des manières de les traiter autrement si nous les comprenons mieux. Ainsi, actuellement, la globalisation de l’économie financière déploie une stratégie de dénationalisation à l’échelle du monde. Là encore, l’adaptation antagoniste entre les formes de sociétés devrait nous prémunir. Il n’y a pas une forme de société nationale qui serait désormais « le mal » et une forme de société mondiale qui serait maintenant « le bien ». Si les acteurs humains ne prennent pas conscience de la riche complexité de leurs inventions culturelles antérieures, leurs inventions actuelles en seront affaiblies. Cette difficile mutation des formes de sociétés, du national au mondial, s’effectue sous une domination du secteur économique et une dévitalisation importante des autres secteurs. Dans cette perspective, le dogme absolu du libre-échange mondial sert à soutenir idéologiquement le secteur dominant de l’économie contre les autres secteurs.
|
|