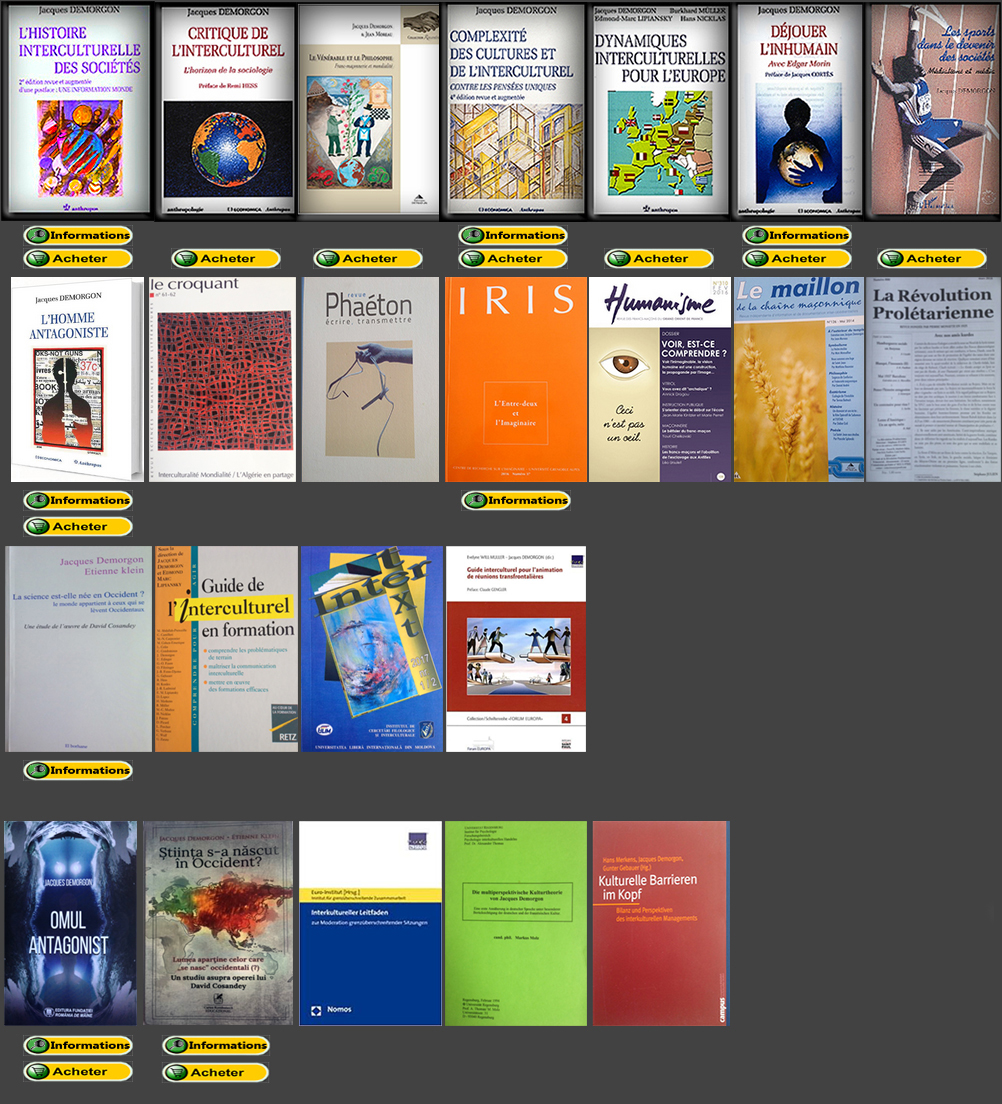|
|
Informations sur le livre
Analyses, préface, introduction, table, extraits, couvertures
Accédez directement à l’information qui vous intéresse en cliquant sur l’un ou l’autre des titres numérotés qui suivent :


|
|
1. N. Carpentier, Questions de communication
1. N. Carpentier, Questions de communication
« Une rencontre avec les 2 400 pages de « La Méthode » d’Edgar Morin pour que la pensée profonde circule et s’échange pour, si possible, parvenir à mieux « Déjouer l’inhumain ». Comment expliquer aux lecteurs l’intérêt de ce petit livre qui ne fait exactement que 118 pages de texte pour traiter d’un projet aussi exigeant que « Déjouer l’inhumain ». Dans la belle et vive préface qu’il donne à l’ouvrage, Jacques Cortès déclare le livre « incontournable ». De quoi s’agit-il ? Un raccourci pour le faire comprendre : comparer le premier titre donné par l’auteur à l’ouvrage et le titre actuel finalement retenu. Le titre originel principal était « Avec Edgar Morin ». C’était dire clairement d’emblée qu’il s’agissait d’une rencontre et d’un échange. Le sous-titre en définissait l’objet problématique : « Une cosmopolitique de civilisation ». Ce terme encore peu employé fit craindre de décourager le lecteur. C’est finalement le titre de la conclusion qui fut choisi comme titre principal de l’ouvrage. On doit bien entendu lire les 2400 pages de La Méthode d’Edgar Morin. Jacques Demorgon s’y est aventuré au long des années. Contribution essentielle à la constitution d’une matière d’action et de pensée indispensable si l’on veut tenter de déjouer l’inhumain. Cette matière d’affect et d’expérience, d’intelligence et d’amour se dresse fondamentalement contre la place en majesté que s’est attribuée notre pensée identitaire. Il n’est question que d’individus, de groupes, d’entreprises, de régions, de nations, de continents qui ne cessent d’agir pour faire en sorte que les autres leur soient subordonnés. Rien ne sert de critiquer cela car ce n’est que le reflet transposé des antagonismes fondamentaux qui structurent le cosmos. C’est précisément parce qu’ils ne savent pas gérer ensemble ces antagonismes fondamentaux qu’un si grand nombre d’humains sont en antagonisme entre eux. Il y a bien des parades à cela mais elles sont si difficiles à découvrir, à comprendre, à formuler et à mettre en œuvre qu’elles ne sont, jusqu’à présent, efficaces qu’à la marge. La pensée identitaire doit se voir réfléchie, reprise, transformée par la pensée antagoniste. C’est seulement ensemble, toutes les deux, qu’elles peuvent constituer la pensée comme l’action systémiques. Tel est l’objet de la première partie du livre. Là encore, l’incompréhension est fréquente quand on confond le systémique avec le systématique, alors qu’il en est l’exact contraire. La pensée systémique trouve ses racines dans une compréhension de la dynamique du cosmos à la vie et à l’humain. Cette dynamique se poursuit à travers toute l’histoire humaine. D’où la deuxième partie de l’ouvrage intitulée « L’histoire systémique » et sous titrée « Acteurs, activités, sociétés ». On ne peut manquer d’être étonné quand on découvre tant d’auteurs – nombre d’entre eux déjà évoqués par Morin – qui éclairent la complexité de l’histoire humaine. Elle ne sépare pas les individus, les groupes, les sociétés. Elle les réunit à travers de « grandes figures de l’humain ». Celles-ci sont toutes caractérisées par leur « logique adaptative antagoniste ». Elle est à l’œuvre dès la moindre action humaine. Ensuite, entre les grandes orientations d’activités – religion, politique, économie, information – qui se sont constituées et sont encore en travail. Chacun de ces secteurs s’érige en mentor de l’avenir humain et charrie largement réussites et catastrophes. Morin parle d’une « entretransformation ». Que de richesses par là mais aussi que de malheurs ! L’histoire humaine s’éclaire, non pour délivrer un sens, mais pour montrer son parcours. Des tribus aux royaumes, des royaumes aux nations, des nations aux sociétés d’économie mondialisée d’aujourd’hui. Hier, les acteurs des secteurs politique et religieux parvinrent un temps à s’associer pour dominer ceux de l’économie et de l’information. Avec le renversement de cette domination, la modernité est née. L’économie et l’information associées dominent aujourd’hui le politique et le religieux avec, de nouveau, des réussites et des catastrophes. L’ère des nations est arrivée avec la « mondialisation anglaise ». L’ère de la globalisation économique et financière est arrivée avec la « mondialisation américaine ». L’histoire reste en cours. Aujourd’hui, tous les continents sont en cause. Dès lors, nous parvenons à la troisième partie de ce bref ouvrage, partie intitulée « Le défi cosmopolitique » sous-titré « de la mère patrie à la terre patrie ». Il nous semble que le point d’interrogation reste sous-entendu pour ne pas décourager. Les connaissances que nous apportent la pensée systémique et l’histoire systémique ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour être assurées de résoudre « le défi cosmopolitique ». Mais si elles ne sont pas suffisantes elles sont indispensables. Sans elles, les humains n’auront pas plus de possibilités qu’hier de faire barrage aux catastrophes inhumaines que nous n’avons d’ailleurs même pas à attendre puisque certaines se produisent, sur toute la planète, avec la fréquence que l’on sait. La conversion des antagonismes destructeurs en antagonismes constructeurs n’est nullement impossible aux humains. Et d’ailleurs ils la mettent toujours partiellement en œuvre quand ils produisent leurs miracles civilisateurs. Il est vrai, cette conversion demande toujours une mise en œuvre de l’intelligence, de l’amour, de l’éducation qui semble largement dépasser les possibilités des humains. Ceux-ci restent trop constamment centrés sur des rivalités dont la dynamique est bien plus perçue comme réductrice que comme productrice et créatrice. À la fin de l’ouvrage, une première bibliographie fait une large part aux œuvres d’Edgar Morin, une 2e évoque nombre ouvrages concernant La Méthode. Une 3e comporte un grand nombre d’auteurs dont les ouvrages fondamentaux constituent un véritable trésor pour toute réflexion et toute action vraiment désireuses de déjouer l’inhumain – projet dont on voudrait croire qu’il pourrait être, un jour, plus constamment et plus fréquemment soutenu. « Bien penser », comme disait Pascal. « Bien faire l’homme » comme disait Montaigne. N. Carpentier, Sorbonne « Paris Descartes » et Crem, Metz.
2. J. Mardirossian, France Arménie
2. J. Mardirossian, France Arménie
« Déjouer l’inhumain » par Jacques Demorgon, philosophe et sociologue étudiant les genèses interculturelles des sociétés. Ouvrage de 130 pages (18euros) Economica, 2010. L’auteur ébauche les conditions nécessaires pouvant générer une nouvelle civilisation pour tous les humains, dans le respect de leur multitude, de leurs différences et contradictions de leurs limites et certitudes, de leurs simplismes et hiérarchies : une cosmopolitique de civilisation. Il rend hommage à Edgar Morin qui a initié cette démarche. Déjouer l’inhumain, c’est remettre en cause des convictions, des processus discriminatoires, des croyances… pour aboutir « à une régénération complète de la vie sociale et quotidienne », dans le cadre de l’interculturalité inscrite dans le champ universaliste. A cet effet, l’auteur distingue 2 formes de logique : la logique du tiers exclu, pensée binaire faisant de l’Autre un ennemi et la logique antagoniste du tiers inclus (inclusion des antagonismes) qui engendre la rencontre, le partage, le respect, l’amour. Pour dépasser l’individualisme égocentrique exacerbé et le tragique des affrontements humains, il faut donc aller au devant de la pensée systémique qui traite « de l’indispensable intégration antagoniste de la pensée identitaire ». Cette dynamique des contraires est renforcée par la science qui réintroduit la complexité du réel. L’antagonisme, plus qu’un choix entre deux opposés, est une opportunité « d’équilibrage adaptatif ». Ainsi dans l’antagonisme unité/diversité, il n’y a pas un pôle du bien et un pôle du mal, mais un moment instable d’équilibration antagoniste, dialogique pouvant faire passer de l’hostilité meurtrière à l’équilibration parfois incertaine. E. Morin dit aussi « il est toujours possible qu’une nouvelle grande barbarie déferle et qu’il nous faille abandonner tout espoir d’hyper complexité… Il faut donc corriger la centration excessive sur tel pôle de ressource, sur tel pays ou sur telle catégorie sociale ». En fait, après la période de domination du religieux puis celle de la sacralisation de la nation dans le cadre du « tout politique », la domination cette fois mondiale du « tout économique » ayant capté l’information, est accentuée du fait de la globalisation financière ; cette dernière fait de plus en plus preuve de carences, d’absolutisme et d’inhumanité. Eu égard à cette situation et aux violences inouïes du XXe siècle, l’auteur laisse entrevoir une possible sortie progressive du tunnel via le développement du savoir et l’appropriation partagée de l’œuvre d’Edgar Morin. Il y a d’une part la théorie d’ensemble, ouverte sur notre liberté et en rupture avec la simplification unitaire totalisante et hyperrationaliste. Elle prend en compte les différentes problématiques en combattant la mutilation du réel au profit de la complexité antagoniste de ce réel ; il y a d’autre part la singularité de l’amour qui propose « un sens de l’humain » et pour en permettre l’éclosion, il faut qu’il bénéficie des apports de l’intelligence. Ainsi, l’hypercomplexité peut faire émerger la cosmopolitique de la civilisation. Mais les grands concepts (démocratie, libération des mœurs) peuvent dissoudre les cultures traditionnelles autoritaires. Cette dialogique concerne l’opposition « unité/diversité », ou mieux « fusion/fission » qui est commune à toutes les sociétés : l’Occident a beaucoup utilisé la fission pour les sociétés traditionnelles et la fusion (assimilation, xénophobie) pour l’intérieur (idem pour la Chine intérieure). EN reconnaissant le caractère positif des contradictions par un traitement heuristique, on pourrait éviter de mettre l’Autre au pied du mur et conjurer les conflits destructeurs…Excellente leçon pour l’Arménie et… pour la diaspora.
3. M. Cornaton, Le Croquant
3. M. Cornaton, Le Croquant
De l’avis de son préfacier, ce nouveau livre de Jacques Demorgon apparaît incontournable pour deux raisons : d’abord il prolonge et explicite la pensée d’Edgar Morin, auquel il est dédié, ensuite, en contrepoint de la pensée aristotélicienne du tiers exclu, au fondement de la raison occidentale, il envisage celle des antagonismes, du tiers inclus, à laquelle nous invite depuis longtemps la réflexion anthropologique d’Edgar Morin. A l’aide du fil d’Ariane que représente l’œuvre de Morin, l’objectif de Demorgon est de retrouver, à travers l’histoire de la science, les pistes permettant d’esquisser une cosmopolitique de civilisation. Non dans la simplification, idéologique ou pédagogique, mais la complexité, qui ne soit pas elle-même ersatz scientifique mais, selon la formule connue d’Edgar Morin, « la complexité, ça n’est pas la solution, c’est le problème ». La société est-elle prête à affronter une réforme intellectuelle totale, condition nécessaire d’une refondation politique ? Demorgon pas plus que Morin n’en est convaincu, d’ailleurs le titre de l’ouvrage nous en apporte déjà la preuve, avant même celui de son introduction : « Le cosmos immense, l’histoire géante et la pensée naine ». Quand Edgar Morin écrit que « l’homme est là par hasard, dans un univers où le chaos est à l’œuvre » ou bien « notre monde est voué à la perdition. Nous sommes perdus… », ce n’est pas une raison, conclut Jacques Cortès, pour désespérer : il est un évangile de la perdition qui, loin d’apparaître comme une invitation au désespoir, se présente comme une exhortation à la lutte pour construire avec autrui la Terre-Patrie. A partir de son concept déjà éprouvé d’intérité, Jacques Demorgon rejoint Edgar Morin dans son agnosticisme ouvert et tranquille. Certes, nous sommes perdus dans l’univers mais tous ensemble. Lisons plutôt les dernières lignes de l’ouvrage. « Morin souligne que c’est ensemble que les humains sont perdus dans l’univers. Ce nouvel évangile de la perdition devrait les rassembler pour inventer un destin cosmopolitique à la fois antagoniste et complémentaire, c’est-à-dire sans doute bien supérieur en civilisation à ce qu’ils ont jusqu’ici tiré de leurs querelles meurtrières. » Dans son chapitre sur les « Figures de la complexité et de l’hypercomplexité », Jacques Demorgon fait référence à la poésie. Si la science, relève-t-il, a dû attendre pour parvenir à identifier les contraires, la poésie quant à elle s’est depuis longtemps attelée à leur conjonction, particulièrement dans la figure de style qu’est l’oxymore, par exemple, « cette obscure clarté qui tombe des étoiles » (Pierre Corneille), « cet affreux soleil noir d’où rayonne la nuit » (Victor Hugo). Or, Edgar Morin pratique depuis longtemps l’oxymore : ainsi le « tout-rien », « le fondement sans fondement de la complexité », l’Europe, « un fondement sans fondement », « la maîtrise immaîtrisée » de la technoscience, « le possible impossible ». Ainsi que le rappelle Morin les oxymores s’inscrivent dans une longue tradition : la pensée chinois du « yin » et du « yang », Héraclite, la Métis des Grecs, ou encore Montaigne et Pascal. Le chapitre consacré à « La pensée systémique et l’épreuve de l’histoire » est inaugurée par une interrogation sur le sens de l’Univers : un sens ou du sens ? « L’histoire du Cosmos, du Bing Bang à nos jours, et celle de la vie, de la cellule à l’humain, n’est-elle pas une « histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. » Une histoire pleine de bruit et de fureur certainement. Mais si elle n’était pas racontée par un idiot et qu’elle signifiait quelque chose ? A présent la question n’est plus celle du sens de l’histoire comme aux temps triomphants des idéologies chrétienne et marxiste mais d’en faire émerger du sens dans l’action. Morin cherche moins à opposer une histoire circonstancielle faite d’incertitude à une histoire pré-organisée qu’à les penser ensemble avec leurs contradictions. A travers le monde nous avons eu des dominations successives. Avec pour commencer le « tout religieux », qui survit en différents endroits de la planète. Lui a succédé le « tout politique », qui croit encore faire la loi. Nous sommes passés au « tout économique », déjà en arrière-plan mais devenu à présent dominant grâce à la globalisation financière. Sommes-nous rentrés dans la quatrième domination, celle du « tout informationnel », plus exactement du « tout médiatique » ? Je considère, pour ma part, que nous nous trouvons pour l’instant dans un tout indifférencié, un patchwork médiatico-économico-politique à consonance idéologico-religieuse. Précisons que cette consonance revêt les formes les plus diverses depuis les aspirations à la spiritualité, composante humaine essentielle, jusqu’aux mascarades de la manipulation en passant par les crispations les plus variées issues de l’angoisse de vivre. Ce n’est pas qu’au nom de je ne sais quel manichéisme je rejette les syncrétismes des doctrines et des connaissances, les métissages des idées et des cultures, les croisements tous azimuts, à une condition cependant, c’est qu’il y ait, tant au cœur des individus que des sociétés, de véritables noyaux d’existence, d’autant plus solides que les élargissements et les rayonnements se propagent. Sinon nous ne retrouverons plus qu’un vaste pierrier, pour ne pas utiliser un mot cru plus évocateur. A défaut de cette unité individuelle et collective, sans cesse reconstituée au fur et à mesure qu’avance la mondialisation, les affrontements humains deviendront tragiques du fait que les identités et altérités ne seront plus qu’imaginaires et, en conséquence, encore plus vulnérables à toutes les formes de manipulation. Ainsi que le souligne avec force Jacques Demorgon dans sa conclusion, on peut toujours déjouer l’inhumain par la violence ; il reprend l’allégorie du nœud gordien tranché, précisant qu’encore une fois on ne fera que repousser le problème. Mais ce pourrait être pire puisque l’utilisation d’un pareil procédé déjouerait l’humain même. En synchronie avec Edgar Morin il ne voit que deux réponses possibles, celles de l’amour et de l’intelligence, concepts évidemment guère politiques. Il n’y a en effet guère que l’amour capable de proposer et de faire advenir un « sens de l’humain », à condition que la fraternité humaine soit accompagnée de l’intelligence, en raison de l’hypercomplexité dans laquelle nous sommes désormais. De l’amour et de l’intelligence non pour trancher le nœud gordien mais pour avoir la volonté de le dénouer et l’intelligence pour comprendre sa genèse et les effets de son dénouement. « L’hypercomplexité demande de l’intelligence, encore de l’intelligence, toujours de l’intelligence », écrit Morin dans La Méthode 2. Déjouer l’inhumain cela signifie chez Edgar Morin d’aller de la Mère-Patrie à la Terre-Patrie, pour Jacques Demorgon de dépasser les invocations de plus en plus incantatoires à la démocratie et aux Droits de l’Homme pour un cosmopolitisme de civilisation.
4. J. Plumasseau, Peut-on faire échouer l’inhumain ? La Révolution Prolétarienne
4. J. Plumasseau, Peut-on faire échouer l’inhumain ? La Révolution Prolétarienne
Jacques Demorgon, dès les premières lignes de sa réflexion, nous entraîne comme par effraction, dans les méandres de la conscience. L’enjeu et le projet d’une telle aventure sont fixés sur une feuille de route qu’il nous appartient à nous, lecteurs, de nous approprier pour déjouer l’inhumain. Cette quête aux frontières du raisonnable, de l’irrationnel, du rêve et de la folie, ressemble à un voyage vertigineux dans un avion qui a perdu tout contrôle et qui nous ramène à nos peurs primales comme lorsque nous traversons une forte zone de turbulences, un poteau noir en quelque sorte ou de façon plus transfigurée, un point aveugle. Demorgon rend lumineux ce qui paraît obscur dans La Méthode d’Edgar Morin. Il m’a projeté au-delà des mots, réalisant ainsi le vœu de Joubert, « rendre commun le sens exquis ». C’est en cela que cet essai ne me semble pas pessimiste contrairement à un certain point de vue, mais en revanche, raisonnablement optimiste. La traduction de la marge dans laquelle s’installe la réflexion de Jacques Demorgon procède de la captation des extrêmes, et cette captation qui tient du constat clinique est forcément désillusionnée. En d’autres termes, l’inhumain fascine, horrifie, et n’a rien d’enchanteur. C’est la raison endogène de l’impossibilité de concevoir ce périmètre de façon candide et irréfléchie. L’excès de lucidité est sans doute perçu comme une forme de pessimisme. Une façon de dire que la nature humaine est capable de se déjouer des pièges de l’inhumain, en ayant la certitude que le mal et ses effets sont des données incurables de notre condition. L’idée novatrice, c’est que le regard que pose J. Demorgon ne consiste pas à abonnir l’inhumain au rang des tabous, mais à tenter de façon raisonnable de l’apprivoiser, comme on le ferait d’un reptile dont la nature obscure résume son être. Pourtant déjouer, c’est faire échouer. C’est aussi ruser. Peut-on faire échouer l’inhumain ? N’est-ce que pas dangereux de ruser avec l’ignominie qui est un choix, avec la folie qui est un enfermement, avec l’hystérie générale qui est commune aux sociétés humaines ? A première vue, il est impossible de déjouer l’inhumain car il est souvent presque par essence imprévisible. Nul n’avait envisagé que les sociétés occidentales développées, fondatrices des droits de l’homme et du principe de sûreté juridique dans la loi, en arriveraient à l’extermination des juifs, des tziganes, aux expériences monstrueuses sur les enfants russes notamment, à la mise en place à grande échelle des lebensborn au nom de l’eugénisme et en définitive à une guerre mondiale qui aurait fait plus de morts en quatre années que toutes les conquêtes napoléoniennes. Pourtant, il y avait la Société des Nations et depuis l’avènement de l’O.N.U., quatre évènements génocidaires sont à dénombrer, les massacres perpétrés par les Khmers rouges, les Serbes, les Albanais et Bosniaques, les Rwandais et désormais les Soudanais. On serait tenté de penser que nous sommes condamnés à vivre avec l’inhumain, pour réparer ensuite ses effets dévastateurs avec tout ce que cela peut comporter de remises en question dans les mémoires individuelles et collectives. De même, ruser avec l’inhumain peut entraîner une attitude de résignation devant un comportement exécrable. Je garde en mémoire la ségrégation raciale aux Etats-Unis, la résignation des Noirs de ce pays jusqu’à la révolte de Rosa Park, l’Apartheid en Afrique du Sud et la même résignation des Noirs de ce pays jusqu’à la révolte des écoliers du ghetto de Soweto, et aussi celle des intouchables en Inde qui fut l’un des enjeux de la partition du pays et l’émergence du Pakistan. Mais quand Edgar Morin écrit que « Notre monde est voué à la perdition. Nous sommes perdus », Jacques Demorgon nous rassure parce qu’il pense « qu’un individu n’est pas d’emblée accessible à des valeurs dites universelles et qu’un travail de réflexion est toujours en devenir, donc inachevé et porteur d’espoir ». Déjouer l'inhumain est donc la quête d'une existence, mais aussi la lente évolution des sociétés humaines. C’est le XVIIIe siècle, celui des Lumières, c'est-à-dire hier, qui invente l'homme abstrait, l'homme valeur propre et unique au centre du droit. L'essentiel n'est pas forcément d'additionner les éléments chaotiques qui s'empilent historiquement et dont la cause est vraisemblablement le mauvais penchant de l'humain. En vérité, l'émergence d'un droit individuel où l'homme est placé au centre des préoccupations de la conscience collective est une idée neuve et éminemment perfectible. Pourtant, il ne faut pas confondre l'acquisition du savoir avec la sagesse, surtout dans des sociétés technicisées. Heidegger dit même que l'inhumain, c'est la technique. Ce qu'il veut signifier, c'est que la technique qui consiste à inventer un fusil d'assaut est accessible à un enfant comme à un ignorant. La technique n'a pas d'esprit, n'a pas de conscience. C'est aussi pour cela qu'il faut concevoir l'inhumain au détour de la science et de la technologie, ce qui rend la civilisation mortelle désormais. Ce ne sont ni la mort des dieux, ni les grands fléaux, ni les crises économiques qui constituent le réel danger, mais l'émergence de la barbarie là où on ne l'attendait pas. Cette inquiétude, relatée par Paul Valéry, explique en quoi il nous appartient dans une société laïque de concevoir un monde désenchanté, démystifié, consumériste, comme viable. Devant « le cosmos immense, l'histoire géante, la pensée naine ne peut s'épanouir que par l'introduction de la trinité adaptative : identité-intérité-altérité ». Cette adaptation est importante parce qu'elle nous amène à deux notions fondamentales : la connaissance et l'intelligence. Jacques Demorgon poursuit en effet : « il faut que ces savoirs et vouloirs soient, par le grand nombre, découverts, transmis, reçus, critiqués, appropriés, étendus, approfondis, assimilés, développés, contredits... pour inventer sur la planète un destin cosmopolite, antagoniste et complémentaire ». A cette réserve près que la vision cosmopolite ne s'exprime pas à travers les échanges dans une vision égalitaire, mais dans une appropriation impérialiste. Le monde civilisateur, c'est l'ensemble du génie humain sur toutes ses formes et dans sa diversité. Les XIXe et XXe siècles ont réussi ce tour de force de faire disparaître les civilisations primitives ou mineures et désormais, ce qui nous guette, c'est l'uniformisation des consciences, le modèle chinois en est une réalité malheureuse. D'où «l'importance de l'intérêt de l'Entre, d'où l'importance des synergies au cœur de l'antagoniste comme articulations spécifiques des forces contraires ». J'ai retenu les degrés de la complexité : « On ne peut pas séparer par une frontière la complexité de l'hyper complexité ». « On ne peut pas séparer le dit et le non dit, la pensée exprimée et la pensée retenue ». Edgar Morin emploie souvent l’oxymore, le tout-rien, le fondement sans fondement de la complexité. Mais quand on parle de destruction créatrice, n'est-ce pas une façon de justifier l'injustifiable ? N'est-ce pas une façon aussi, face à la complexité, de prendre position, d'occulter l'intérité ? N'est-ce pas, en définitive, le point limite, le point aveugle des sciences sociales ? Nous avons voulu, écrit Jacques Demorgon, une appropriation à la fois personnalisée et plus partagée de l'œuvre d'Edgar Morin. Il faut des mots pour exprimer la pensée, certes, mais il faut aussi des mots pour faire comprendre cette pensée et pour permettre sa divulgation. Jacques Demorgon m'a permis de faire une avancée significative dans l'œuvre d'Edgar Morin. Parce qu'Edgar Morin est parfois, à mon avis, difficile à saisir entièrement par des intelligences en gestation. Jacques Demorgon le ressent. C'est pourquoi, il dit d'une manière très fine qu'il accompagne les tracés notionnels, méthodologiques et théoriques d'Edgar Morin. Le terme « accompagner » me semble précieux et respectueux, dans la mesure où l’auteur de Déjouer l'inhumain veut faire de toutes les données des parties intégrantes de notre culture d'aujourd'hui. Aussi faut-il le remercier de nouveau de nous avoir entraîné dans son sillage et de nous avoir permis d'avoir une lecture plus affinée de l'œuvre d'Edgar Morin. Quand Jacques Demorgon affirme que le mal reste une donnée incontournable, irréductible, de notre expérience, que le mal ne dépend pas des seuls humains, Déjouer l'inhumain me semble donc, face à l'inéluctable, une attitude positive, car elle laisse entrevoir qu'il faut parfois voyager à travers la mémoire du mal pour trouver le courage de le regarder de face, de le juger, de le condamner en tentant de rendre cette expérience exemplaire.
5. J. Moreau, Humanisme
5. J. Moreau, Humanisme
Voici un livre au titre superbe, susceptible d’éclairer et de motiver l’engagement humaniste. Le thème : la possibilité d’une espérance. C’est celle de la Terre-patrie à laquelle déjà rêvait Jaurès en assurant « qu’il n’y a pas de certitude toute faite en Histoire » mais qu’il est aussi des forces vivantes, certaines, vérifiables, pour concevoir un vivre-ensemble. Jacques Demorgon ne dénie jamais la dure vérité du réel et ne sépare pas, par conséquent acteurs, activités, sociétés et cultures. En effet, idée essentielle : religion, politique, économique, information s’entre-transforment aussi bien au niveau des individus qu’au sein des groupes. Seul « un cosmopolitisme de civilisation » peut nous faire atteindre de nouvelles frontières. Le philosophe commence par une critique de la pensée simplifiante qui se limite au principe du tiers-exclu aristotélicien en enracinant une Raison déifiée dont les modalités sont pourtant diverses dans le seul Occident. Novateur, il lui substitue la logique des antagonismes-inclus qui embrasse le Tout-Monde (Edouard Glissant) ou la Terre-Patrie (Edgar Morin). Elle fonde une anthro-politique. C’est dire que déjouer l’inhumain exige que l’on s’initie à la pensée systémique qui conduit de l’individu au cosmos et refuse un réel mutilé par des représentations qui ignorent la complexité. Une telle démarche refuse une dialectique de type marxiste (thèse, antithèse, synthèse) pour recommander ce qu’Edgar Morin appelle la dialogique qui n’ignore pas l’antagonisme, la concurrence, la complémentarité. Comprendre en effet l’antagonisme comme fondement du réel est la première condition pour le reconnaître et construire des réponses adaptées. Déjà Héraclite, Nicolas de Cuse, Hegel, Bohr, Jung, Piaget, Lupasco, l’avaient suggéré. Pascal, lui-même n’écrit-il pas que « La source de toutes les hérésies est de ne pas concevoir l’accord de deux vérités opposées ». Jacques Demorgon envisage par conséquent des synergies au cœur de l’antagonisme. C’est ainsi que, dans le sport, celui-ci évite la guerre. Les figures de la complexité et de l’hyper-complexité surgissent dans la trinité humaine : (individu, société, espèce), dans le pentagramme (ordre, désordre, organisation désorganisation, plus, au centre, interactions). Le philosophe relève les oxymores, nombreuses chez Edgar Morin (l’un-multiple par exemple) ainsi que les crases (procédé linguistique fusionnant deux mots : ainsi l’organisaction, l’informaction) qui rappellent la préoccupation fondamentale de notre Frère Goethe : « Au début était l’action ». L’essai dont on ne donne ici que quelques aperçus, est étincelant : il invite, entre lucidité critique et utopie heureuse, les Francs-Maçons et leurs obédiences à analyser et à penser au-delà des incantations souvent passéistes qui nous animent, le monde qui vient, à combattre au cœur de sociétés différentes le règne de l’économisme et à corriger les identités meurtrières. Dans une telle perspective, « le mal et le bien, l’amour et l’intelligence se voient autrement : amour et fraternité ne sont ni dictables, ni programmables mais fondent la lutte interminable contre la cruauté ». Cela fait réfléchir : depuis le discours du Chevalier Ramsay, les Maçons croient à l’importance de l’instruction, de la connaissance et de la culture, sans toujours se rendre compte que ces manifestations sont extrêmement hétérogènes. Ils croient en Homo Sapiens-Sapiens, mais ont-ils mesuré sa complexité ? Par ailleurs, en dépit des bonnes intentions exprimées ou des bons combats menés, cela n’a jamais empêché Homo Demens de se manifester sans cesse. Déjouer l’inhumain ne peut pas se satisfaire d’invocations à la démocratie et aux Droits de l’Homme mais exige de repérer les inégalités destructrices des humains, d’inventer les moyens pour les dépasser et « aller ainsi de la Mère-Patrie à la Terre-Patrie »…
Ce texte est également publié en ligne : Jean Moreau, «Jacques Demorgon, Déjouer l’inhumain. Avec Edgar Morin», Les Cahiers de Psychologie politique [En ligne], numéro 17, Juillet 2010. http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1720
6. J. Cortès, Préface : « La Possibilité d'une espérance : la Terre-Patrie »
6. J. Cortès, Préface : « La Possibilité d'une espérance : la Terre-Patrie »
Ce nouveau livre de Jacques Demorgon, dédié à Edgar Morin, me semble incontournable à deux titres : d’abord pour prolonger, avec l’auteur de la Méthode et de Terre-Patrie, un échange dont la très préoccupante actualité mondiale accroît chaque jour la nécessité ; ensuite, de façon plus distanciée, pour compléter autant que possible la logique rituelle très aristotélicienne du tiers exclu, sur laquelle s’est longtemps fondée et se fonde toujours en grande partie la raison occidentale, pour envisager également celle des antagonismes inclus (ou du tiers inclus) à laquelle nous invitent autant les sciences de la nature et les sciences dites « dures » que la réflexion anthropolitique prônée – entre autres – par Edgar Morin. L’objectif que se fixe Jacques Demorgon est de retrouver, dans l’Histoire ancienne et contemporaine de la science, les pistes pouvant permettre d’imaginer et même d’esquisser une cosmopolitique de civilisation. Entendre par là d’une civilisation qui vaille non plus simplement pour un peuple ou une nation imbu(e) de sa supériorité sur le reste du monde ou de sa place d’élue sous le regard de Dieu, mais pour l’humain dans sa multiplicité, ses différences, ses contradictions, ses limites, ses refus, ses certitudes (notamment religieuses), son simplisme, ses classifications, ses hiérarchies, bref, dans sa complexité qui, comme le rappelle Morin, ne doit pas être caricaturée en panacée de la science, ni en solution et absolution miracles de tous les péchés du monde, mais en problème à résoudre ( « la complexité, ça n’est pas la solution, c’est le problème » - Morin, 2007 :49). J’évoquerai ici, très librement, mon parcours de lecture dans ce livre passionnant, qui complète avec clarté, profondeur et érudition les ouvrages antérieurs d’un auteur désormais incontournable sur les questions culturelles au plan international.
Nécessité d’une politique planétaire…
Dans le tome 4 de la Méthode consacré aux Idées, Morin écrivait en 1991 (p.10) : « … de même que j’ai voulu rappeler que toute connaissance humaine émerge sans cesse du monde de la vie, au sens biologique du terme, je tiens à rappeler ici que toute connaissance philosophique, scientifique ou poétique émerge du monde de la vie culturelle ordinaire ».Une société humaine, quelle qu’elle soit, fonctionne ainsi comme une machine anthroposociale. L’analyse systémique permet d’en expliquer l’évolution historique généralement fondée sur le concept classique très sanctuarisé de Mère-Patrie, mais par extension maximale, c’est la société humaine dans son entier (le Tout-Monde de Glissant, par exemple), qu’on peut hypothétiquement, avec Morin et Demorgon, considérer comme finalité humaniste suprême, à la condition expresse de quitter le domaine communautaire étroit du patriotisme local et de ses dérives guerrières, pour accéder au niveau planétaire de la Terre-Patrie. C’est là, dans la voie tracée par l’œuvre d’Edgar Morin, la visée profondément humaniste du livre de Jacques Demorgon, dont chaque page est l’explication lumineuse d’un projet qui ne se propose en aucune façon de donner la recette d’une universelle fraternité – la vérité (comme l’erreur) est une lente construction – mais de poser les bases d’une culture polycentrique, donc mondialiste au bon sens du terme, susceptible « de fonder une « anthropolitique « et une politique planétaire » (E.Morin, 2008, p.7).
« Déjouer l’inhumain » (formule « choc » de Jacques Demorgon)
A la base du livre de Jacques Demorgon, un évident pessimisme. La société est-elle déjà prête à envisager une réforme intellectuelle débouchant sur une refondation politique aussi importante que celle consistant à prôner une cosmopolitique de civilisation ? Jacques Demorgon n’en est d’évidence pas plus convaincu qu’Edgar Morin. Même si quatre décennies se sont écoulées depuis la publication du Paradigme perdu, en matière d’anthropolitique nous en sommes toujours « aux débuts de la connaissance » concluait Morin (1973, P.234). C’est toujours le cas. Et si J. Demorgon, de son côté, intitule sa conclusion Déjouer l’inhumain, cela suggère assez qu’un individu n’est pas d’emblée accessible à des valeurs dites universelles en totale contradiction avec celles qui l’ont ontologiquement nourri. Déjouer l’inhumain, au sens strict, c’est juguler, entraver, enrayer les certitudes en vue de tenter une réorientation radicale. Il faut donc – et le titre de Jacques Demorgon le dit explicitement – ruser avec l’inhumain et le mettre en échec pour contrecarrer un système de valeurs discriminatives. L’entreprise est grande et belle mais de l’ordre de l’impossible car les valeurs culturelles de chacun sont d’évidence sacrées dans la mesure où, précisément, elles apparaissent comme une nourriture spirituelle indispensable : sans elle, en effet, c’est la mort de l’âme mais aussi la rupture avec l’environnement communautaire, l’isolement terrestre et même la solitude métaphysique dans un espace qui ressemble à s’y méprendre, la foi en moins, à la terreur pascalienne dans les Pensées (« le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie »). Dès lors, prôner une cosmopolitique de civilisation, c’est tenter d’imposer à l’individu le préalable de se couper de tout avant et de tout après, afin de l’amener, pendant le court passage terrestre, à une « régénération complète de la vie sociale et de la vie quotidienne ». Dès le titre allégorique de son introduction («Le cosmos immense, l’histoire géante et la pensée naine »), Demorgon choisit des mots qui parlent d’eux-mêmes : le cosmos, l’histoire et la pensée. Leur renforcement adjectival (immense, géante, naine) est presque pléonastique, du moins pour les deux premiers : l’immensité est inhérente au cosmos comme le gigantisme l’est à l’Histoire des hommes. C’est donc la pensée seule qui fait problème dans la mesure où elle ne parvient pas à entrer de plain-pied dans l’intelligibilité de l’espace et du temps. Sans doute parce qu’elle détourne son regard vers autre chose que l’humain.
Logique identitaire et logique antagoniste
Quelle est donc la cause la plus probable de ce nanisme de la pensée ? Lorsque Morin et Demorgon parlent de cosmopolitique de civilisation, ils veulent d’évidence s’élever bien au-dessus de l’actualité immédiate et de l’individualisme exacerbé qui s’affichent à tous les étages de la société. Plusieurs projets utopiques ont traversé l’histoire. Ils sont fondés, nous dit Basarab Nicolescu, sur trois types d’espérance : « l’espérance du corps (conduisant à une vision particulière de la santé et du bien être) ; l’espérance du sentiment (conduisant à une éthique fondée sur la fragilité de l’autre) et l’espérance de la pensée (conduisant à des idéologies). Il me semble évident – écrit fortement l’auteur - que l’expérience historique entière nous montre que l’absolutisation de ces trois types d’espérance ne peut aboutir qu’à des impasses. Notre civilisation favorise tout particulièrement l’espérance de la pensée qui a conduit aux camps de concentration et aux guerres » . Il faut donc changer de voie, sortir de l’individualisme et de l’intolérance qui sont la marque indélébile de ce qui précède. Pour simplifier beaucoup les faits, disons que Morin et Demorgon distinguent entre les deux formes de logiques (l’une n’excluant pas l’autre mais la complétant) déjà mentionnées au début de cette préface : - la logique identitaire du tiers exclu est toujours inscrite dans une pensée « métaphysique, binaire, morcelée, partielle et partiale »faisant de l’autre l’ennemi ; - la logique antagoniste du tiers inclus (ou des antagonismes inclus) implique non plus la destruction de l’autre et le « choc des civilisations » mais la rencontre, le partage, le respect, l’amour, la poésie, la redéfinition d’un monde nullement déicide mais enfin détaché de tous les dogmes sacrés faisant de lui l’entité barbare et partisane que l’on sait. Dans la logique identitaire présente historiquement dans toutes les spiritualités, le croyant considère comme un fait indubitable que Dieu, par un intermédiaire humain choisi par lui, a dicté à l’homme sa loi et lui a intimé l’ordre sacré de la propager telle quelle. Le devoir de conversion peut alors prendre des formes possibles de prosélytisme (l’histoire de l’humanité en est remplie) pouvant aller jusqu’à l’élimination pure et simple du récalcitrant. L’impureté supposée de ce dernier, en effet, entraîne la conséquence inéluctable que tout commerce avec lui ne peut être que minimal ou nul, donc exclusif de toute fusion. A partir d’un modèle de ce type, les cultures amenées à coexister sur un même territoire, ne peuvent espérer autre chose, dans le meilleur des cas, qu’une simple juxtaposition conjoncturellement pacifique. Le moindre problème risque de dégénérer en conflit. Dans la logique antagoniste, l’humain prend enfin le dessus pour remettre en quelque sorte Dieu à la place sacrée qui est la sienne, nullement pour tourner en dérision ce concept (ce qu’il est jusqu’à preuve du contraire) utile et même nécessaire, mais au contraire pour le dégager de l’esprit sectaire auquel veulent le réduire ses défenseurs les plus vindicatifs. Car c’est décidément faire injure à Dieu que de vouloir transformer une abstraction universelle de bonté, d’indulgence et de pardon en un très ordinaire Moloch demandeur de sang humain.
L’évangile de la perdition
C’est précisément parce que Dieu n’a pas de religion, à moins de l’imaginer assez vain pour s’adorer lui-même, que l’Homme doit revoir ses certitudes. Le pari de Pascal reste probablement toujours d’actualité, mais à condition de l’envisager dans un esprit respectueux de toute croyance (dès lors que chacune d’elles aura fait l’effort de gommer toutes ses dérives et rites inacceptables). On peut donc faire, avec Pascal, le pari que Dieu existe et ne rien avoir à redire à la multiplicité des groupements humains qui l’adorent d’une façon ou d’une autre, mais nul athéisme offensant ou dangereux n’est perceptible dans le positionnement philosophique d’Edgar Morin ou de Jacques Demorgon. En fait, tous deux pratiquent un agnosticisme tranquille même si parfois, au détour d’un texte, on trouve chez l’un ou l’autre, chez Morin par exemple, certaines phrases que Séverin Abbatucci – fervent admirateur de Teilhard de Chardin – considère comme la négation de Dieu . Il en va ainsi de l’évangile de la perdition : lorsque Morin écrit : « l’homme est là par hasard, dans un univers où le chaos est à l’œuvre » ou bien encore : «notre monde est voué à la perdition. Nous sommes perdus… », il ne faut ni oublier, ni sous-estimer la suite qui est grandiose et qui n’exclut rien, même si, dans l’état actuel de nos connaissances, nous n’avons aucun argument autre que la foi pour imaginer une solution mystique à notre destin. Le constat de la perdition, loin d’être une invitation au désespoir et au découragement, est simplement une exhortation à la lutte ici-bas, pour construire la Terre-Patrie, en pleine solidarité avec autrui. La visée profonde est donc la régénération de l’humanité en profondeur, c’est-à-dire de l’ensemble complexe en relation étroite : individu/société/espèce pour le délivrer de la barbarie civilisée dont, quotidiennement, nous voyons les effets pervers, cruels et vicieux s’étaler en pleine lumière. Il s’agit donc de « sortir de l’Histoire par le haut » et cela ne peut se faire qu’au prix d’une métamorphose de toutes les sociétés refermées sur elles-mêmes et donc mutuellement hostiles les unes aux autres, en une société-monde dont l’éthique, c’est-à-dire l’art de bien penser, aura pour enjeu vital de « résister à la cruauté du monde et à la barbarie humaine ». Cet ouvrage marque une nouvelle étape dans la réflexion de J. Demorgon. Les nombreux lecteurs et admirateurs de ses écrits antérieurs savent que sa pensée, comme celle de tout chercheur, fonctionne sur le mode de l’intérité, concept à mi-chemin entre l’identité et l’altérité, signifiant qu’un travail de réflexion (quel que soit le domaine envisagé) est toujours en devenir, donc inachevé. Le cheminement scientifique de Demorgon est ici marqué explicitement par le nom d’Edgar Morin annoncé, dès le titre de l’ouvrage, comme catalyseur de sa réflexion. Mais la bibliographie rassemble une bonne centaine de références attestant que la parole a été largement distribuée. La question interculturelle est toujours au cœur de ce nouveau livre, mais, considérablement élargie, elle se trouve désormais plus que jamais inscrite dans le champ universaliste d’une cosmopolitique de civilisation. Nous sommes peut-être perdus dans l’univers nous dit Demorgon, mais c’est ensemble ; et il termine par une phrase qui est un véritable acte de foi humaniste: « Ce nouvel évangile de la perdition devrait rassembler (les humains) pour inventer un destin cosmopolitique à la fois antagoniste et complémentaire, c’est-à-dire sans doute bien supérieur à ce qu’ils ont jusqu’ici tiré de leurs querelles meurtrières ».Nous lui en donnons acte bien volontiers.
Sylvains les Moulins, le 18 janvier 2010 - Jacques Cortès – Président du GERFLINT
7. Introduction inédite de Jacques Demorgon
7. Introduction inédite de Jacques Demorgon
A l’origine de « Déjouer l’inhumain », Jacques Cortès nous avait fait l’amicale proposition de lui donner un article pour un ouvrage portant sur les travaux d’Edgar Morin. J. Cortès rejoignait là une préoccupation personnelle ancienne mais toujours vive. Notre engagement en faveur d’une pensée antagoniste correctrice de la pensée identitaire dominante s’était exprimé déjà dans un article paru dans Synergies France 4 en 2005 et dans Synergie Chine. Elle y reconnaissait sa dette à l’égard de l’œuvre de Stéphane Lupasco. Sur cette œuvre E. Morin lui-même avait enchaîné avec sa Méthode dialogique dont nous nous étions bien évidemment inspiré. Edgar Morin est un contributeur exceptionnel de la pensée antagoniste. Il nous paraissait fondamental de retrouver le détail des chemins qu’il invente. Nous avions rédigé un texte élargi intitulé : « avec Morin, du Cosmos à l’Humain – l’hypercomplexité comme représentation et comme volonté – En dépit de sa taille importante, J. Cortès accepta d’associer ce texte à tous ceux produits en « Hommage à Edgar Morin pour son 87ème anniversaire », dans Synergies Monde 4, en 2008. Plusieurs développements de cette première étude nous ont conduit à produire un livre bref et sans doute trop dense non sur la totalité des travaux d’Edgar Morin mais sur son centre méthodologique systémique. Comme naturellement Jacques Cortès accepta d’en rédiger la préface. Nous avons apprécié l’accueil de cet ouvrage par les Editions Economica dirigées par Jean Pavlevski. Edgar Morin me dit qu’il avait retrouvé avec bonheur déjouer l’inhumain à son retour d’un voyage aux Etats Unis, s’étonnant de ma profonde implication dans son œuvre au cœur même de mes travaux. Je recevais en même temps un mot chaleureux de Yves Lacoste pour l’éclairage synthétique de la Méthode de Morin et sa relation à nombre d’auteurs encore souvent méconnus.
8. Table des matières
8. Table des matières
Préface de J. Cortès, La possibilité d’une espérance : la Terre-Patrie
Introduction. Le cosmos immense, l’histoire géante et la pensée naine
LA PENSÉE SYSTÉMIQUE : DE L’INDIVIDU AU COSMOS
I. Critique de la pensée simplifiante
II. Les antagonismes du réel et la méthode systémique
III. Figures de la complexité et de l’hypercomplexité
IV. Du Cosmos à la vie. Antagonismes et synergies
L’HISTOIRE SYSTÉMIQUE : ACTEURS, ACTIVITÉS, SOCIÉTÉS
V. La pensée systémique et l’épreuve de l’histoire
VI. Dialogique des actions, des activités, des appareils
VII. L’organisation systémique des royaumes et la raison des sociétés divergentes
VIII/ Chine, Europe : dialogiques analogues ou divergentes
LE DÉFI COSMOPOLITIQUE. DE LA MÈRE-PATRIE A LA TERRE PATRIE
IX. L’Europe antagoniste et « l’association, dissociation » du politique et du religieux
X. La nation moderne, l’économie et l’information associées
XI. La mondialité et l’ascension de l’économie financière
XII. Le défi cosmopolitique : l’humain multiple
Conclusion. Déjouer l’inhumain
Bibliographie
|
|